La vision européenne de l’Indopacifique
Résumé
- Le lancement de la stratégie de l’UE pour l’Indopacifique devrait marquer le début d’une nouvelle approche de la région.
- Mais les recherches de l’ECFR montrent que, malgré l’importance économique et politique croissante de l’Indopacifique, de nombreux États membres ne s’intéressent toujours pas aux événements qui s’y déroulent.
- Il faudra plus qu’un soutien fort de la France, de l’Allemagne et des Pays-Bas pour s’assurer que la nouvelle stratégie de l’UE pour l’Indopacifique soit efficace à long terme.
- Ces trois pays ont l’occasion de convaincre les autres États membres que la région est vitale pour la souveraineté et la prospérité de l’Europe.
- Ils peuvent y parvenir en créant des projets d’ampleur qui démontrent leur présence et leur volonté dans l’Indopacifique, et en établissant des coalitions pour un plus grand engagement européen dans des domaines tels que la technologie et la sécurité maritime.
Introduction
Le centre de gravité économique et géopolitique de la planète se déplace depuis des années vers l’Indopacifique. La Chine jouant un rôle de plus en plus dominant partout, du commerce à la puissance militaire en passant par les développements technologiques, le déclin relatif de la suprématie américaine est très perceptible dans la région. Cela pose un nouveau défi à l’Europe, dont l’avenir économique et la pertinence géopolitique sont inextricablement liés aux développements en Asie.
Cela fait des dizaines d’années qu’en Europe les décideurs politiques travaillaient d’arrache-pied sur des développements stratégiques pour l’Indopacifique qui ne portaient pas sur le commerce. Depuis le début des années 2000, l’Union européenne s’est beaucoup penchée sur ces questions en interne ou dans son voisinage immédiat.
Le concept « d’Indopacifique » a d’abord émergé dans la région – en particulier au Japon et en Australie – et a reformulé le récit précédemment dominant « Asie-Pacifique », principalement pour pouvoir articuler les exigences de ces pays en matière de prospérité vis-à-vis de la Chine et de leur dépendance à l’égard de la garantie de sécurité américaine. Le gouvernement Trump s’est approprié le concept et lui a donné une connotation nettement anti-Chine. Jusqu’à l’année dernière, l’UE n’avait pas largement conceptualité l’idée de l’Indopacifique, et encore moins défini ses priorités politiques pour la région. L’Union craignait que procéder ainsi signifierait un alignement avec les Etats-Unie et aliènerait la Chine. Par conséquent, la notion selon laquelle il existait une région Indopacifique avec laquelle discuter ne s’était guère imposée en Europe. Mais plusieurs États membres de l’UE incitent maintenant Bruxelles à considérer l’Indopacifique comme un concept stratégique.
Ces dernières années, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas ont élaboré, de différentes façons, des stratégies nationales pour l’Indopacifique. Ils ont été les moteurs des efforts de l’UE pour s’accorder sur une approche plus claire de la région. Cela a conduit à la publication des conclusions du Conseil européen sur la « Stratégie de l’UE pour la coopération dans l’Indopacifique » en avril 2021, qui a ouvert la voie pour que l’Union adopte une stratégie officielle qui peut maintenant entamer une nouvelle approche. Pour passer de l’état de projet à sa mise en œuvre, les Européens devront répondre à plusieurs questions difficiles qui sont en contradiction avec la langue consensuelle des documents européens.
L’UE peut-elle réellement « être stratège » au sujet de ses intérêts et des priorités de ses États membres dans l’Indopacifique ? Mis à part les pays qui affichent clairement une préférence pour une approche plus active, certains États membres sont-ils fortement opposés à un plus grand engagement de l’Europe dans la région ? L’indifférence l’emportera-t-elle ou l’UE a-t-elle connu un réveil stratégique qui recentrera sa politique sur l’énorme potentiel de la région en faveur des intérêts européens ? (Question qui s’applique aux domaines qui vont du commerce à la défense de l’ordre fondé sur des règles, en passant par le Pacte vert européen, le financement des infrastructures et l’assistance au développement.) Et quel rôle joue le facteur Chine ?
Il faudra probablement bien plus qu’une forte offensive de la part de la France, de l’Allemagne et des Pays-Bas pour s’assurer que l’UE mette en place une stratégie à long-terme dans l’Indopacifique. Et donc, quelle est la position des États membres sur cette question ?
Le présent rapport s’inspire d’un sondage que l’ECFR a mené pour comprendre comment les principales parties prenantes politiques de chaque État membre voyaient la perspective d’une nouvelle forme de collaboration européenne avec l’Indopacifique et de cadre conceptuel de cette région. Les résultats de ce sondage réalisé auprès d’experts montrent que, en dépit de l’importance économique et politique croissante de la région, c’est l’indifférence qui l’emporte dans de nombreux États membres de l’UE. Cela laisse entendre que ceux qui mènent les débats devraient faire davantage d’efforts pour présenter une histoire convaincante sur les raisons pour lesquelles l’Europe devrait être active dans l’Indopacifique et comment elle pourrait collaborer plus efficacement avec ses partenaires dans la région – en utilisant ses propres forces dans un monde de rivalité croissante entre grandes puissances.
Les résultats du sondage mettent en exergue l’intensité – ou l’absence d’intensité – du débat autour de l’Indopacifique dans chaque État membre. Ces différences pourraient finalement limiter l’impact de toute réorientation stratégique. Il y a un risque que l’approche européenne de l’Indopacifique ne soit rien de plus que la somme des politiques disparates qui sont seulement faiblement liées entre elles et qui ne parviennent pas à créer de nouveaux partenariats entre l’Europe et les pays et organisations de l’Indopacifique. Pour empêcher cela, les principaux acteurs devront transformer la stratégie en réalité.
Les données indiquent qu’ils peuvent le faire : étant donné que l’indifférence plus qu’une véritable opposition parmi les États membres est le problème, il devrait être possible d’établir des positions plus déterminantes et visibles sur les enjeux de l’Indopacifique. Si certains groupes d’États membres créent des projets d’ampleur qui marquent leur présence et leur sérieux dans la région, ils peuvent susciter une dynamique de collaboration européenne encore plus grande – et de ce fait renforcer la souveraineté et la prospérité européennes. Dans ce contexte, la stratégie pour l’Indopacifique peut être importante pour aider l’Europe à repenser son rôle dans le monde.
Une stratégie émergente
Au mois d’avril, le Conseil de l’UE a publié ses conclusions sur la « Stratégie de l’UE pour la coopération dans l’Indopacifique » et les 27 ministres des Affaires étrangères de l’UE ont formellement invité Josep Borrell à présenter une nouvelle stratégie digne de ce nom pour la région d’ici septembre 2021. Au regard des standards de l’UE, c’était une performance – 20 mois auparavant, l’expression « région Indopacifique » ne figurait même pas dans les documents officiels ni dans l’UE ni dans ses États membres. La France seule, faisait exception, car elle avait élaboré sa propre stratégie en 2018 (avant de la revoir en 2021) et elle avait cessé depuis de prôner l’adoption d’un équivalent au niveau européen. Concernant ses territoires d’outre-mer dans la région, la France est le seul pays européen qui se considère comme une « puissance résidente » dans l’Indopacifique. Sans ce rôle, d’autres États membres semblaient réticents à adopter formellement le concept. Cela est dû à ses connotations géopolitiques. La publication en Allemagne de ses « Policy guidelines for the Indopacific region » en septembre 2020, suivie de peu par les propres orientations politiques des Pays-Bas, a marqué le début d’une démonstration de la part des pays en dehors de la France selon laquelle il n’est pas indispensable d’être une puissance résidente pour avoir, et formuler clairement, des intérêts dans l’Indopacifique.
Par conséquent, le débat sur la région commence maintenant à gagner du terrain. Il a donné lieu récemment à la publication des conclusions du Conseil – qui, à leur tour, se traduiront par une véritable stratégie de l’UE. La publication de ces conclusions devait être approuvée par l’ensemble des 27 ministres des Affaires étrangères de l’UE, c’est-à-dire que chaque État membre a été obligé d’aborder la question de l’Indopacifique à ce niveau.
La vitesse de cette réorientation est toutefois symptomatique d’un changement des perceptions des rapports de force internationaux et de leur impact potentiel sur l’Europe. Les Européens ont été obligés de repenser, à cause de leurs craintes, aux conséquences de la montée en puissance de la Chine – et à cause de leur incertitude au sujet de l’engagement des Etats-Unis dans la sécurité européenne et sa propension à protéger les intérêts européens des conséquences potentiellement négatives de la rivalité sino-américaine. Ces facteurs réunis révèlent la centralité du thème de la Chine – aboutissant aux questions de plus en plus difficiles de la posture que l’UE devrait adopter vis-à-vis de Pékin. Et, tandis que les relations transatlantiques se sont singulièrement refroidies sous le gouvernement Trump, les activités géopolitiques de Pékin – de sa « diplomatie du masque » pendant la pandémie de la Covid-19 à ses actions à Hong Kong et à Xinjiang – ont chassé l’optimisme relatif des Européens au sujet de la future orientation des relations UE-Chine. La pression exercée sur l’Europe s’est considérablement accrue pour s’adapter aux relations de plus en plus polarisées et tendues entre la Chine et les Etats-Unis.
Jusqu’à présent, les efforts des Européens n’ont pas réussi à formuler de réponse à ces développements. La stratégie américaine pour l’Indopacifique nomme explicitement la Chine comme « rivale stratégique ». En revanche, les stratégies nationales de la France, de l’Allemagne et des Pays-Bas cherchent à éviter le difficile positionnement de la question chinoise en insistant sur « l’inclusivité » – en suggérant que Pékin devrait être davantage un partenaire plutôt qu’un rival. La véritable division au sein de l’Europe, cependant, ne semble pas être de savoir si la Chine fait partie du concept de l’Indopacifique. Au contraire, elle comporte deux approches opposées de l’inclusivité. La première approche ne reflète rien d’autre qu’un désir d’éviter le problème chinois en insistant sur le besoin de coopérer avec tous et en éludant les aspects potentiellement problématiques de la relation. La seconde approche reconnaît les conflits d’intérêt et les différences de valeur avec Pékin mais prône néanmoins une coopération continue avec la Chine, de manière à inciter Pékin à adhérer aux normes et formes de comportement acceptées à l’échelle internationale.
La division qui caractérise l’approche ambivalente de l’Europe à l’égard de Pékin vient des différences fondamentales qui existent dans les comportements des États membres face au défi chinois. Cela est particulièrement évident lorsqu’on compare la stratégie française aux orientations politiques de l’Allemagne. Les Français ont insisté dès le départ sur la nécessité d’éviter l’émergence d’une nouvelle hégémonie et de rétablir des « règles de jeu équitables » dans les relations de l’Europe avec la Chine. Pour autant, le texte allemand fait seulement soigneusement allusion à la notion de contrer la Chine et consacre nettement plus d’attention aux opportunités économiques offertes par la « région » Indopacifique plutôt qu’aux questions sécuritaires sous-jacentes.
Le sondage
Le réseau paneuropéen de l’ECFR de chercheurs nationaux a mené des entretiens qualitatifs avec des parties prenantes dans leurs États membres respectifs de l’UE. Ces parties prenantes étaient des décideurs politiques, des députés, des ministères compétents et des experts réputés du monde universitaire et du secteur caritatif. Un questionnaire a été élaboré pour faciliter les entretiens et produire des résultats comparables. Les réponses sélectionnées ont été prédéfinies dans un sondage mais ont été choisies sur la base de l’évaluation globale des chercheurs des opinions de leurs États membres. Les réponses des participants portent uniquement sur la stratégie émergente de l’UE et peuvent varier selon les préférences nationales.
Les Français prônent une stratégie européenne depuis 2018 mais ce n’est qu’après la publication des orientations politiques allemandes que la dynamique a été suffisante pour inciter d’autres États membres à appuyer le concept de l’Indopacifique. Le fait que ces deux pays, ainsi que les Pays-Bas, aient prôné conjointement une stratégie pan-européenne a facilité le processus. Toutefois, cela n’a en rien éliminé les divisions entres les États européens dans leur volonté d’insister sur leurs différences avec la Chine, tout comme la stratégie Indopacifique de l’UE qui en résulte n’y parviendra pas. Même si on ne sait pas encore clairement dans quelle mesure cette stratégie sera significative, cela dépendra de deux choses : son contenu et, finalement, sa mise en œuvre. L’Europe devra fixer des objectifs mesurables et travailler pour les atteindre en s’engageant financièrement et de manière durable dans la sécurité de la région.
Il est remarquable que l’UE soit allée aussi loin. Les États membres ne sont toujours pas d’accord sur une définition géographique de l’Indopacifique ou sur ce que le concept signifie. L’Indopacifique n’est pas un espace prédéterminé où l’on peut appliquer les stratégies nationales des États – encore moins une stratégie européenne. Au contraire, les intérêts spécifiques des États façonnent leur compréhension de ce qu’est l’Indopacifique et de sa localisation. Ceci n’est en aucun cas un débat académique. Les définitions divergentes montrent des intérêts divergents – et, potentiellement, différents degrés d’implication dans la création d’une stratégie de l’UE pour l’Indopacifique. Qui plus est, ces différences entre les pays dans la conceptualisation de l’Indopacifique en tant que zone géographique pourraient limiter leur participation politique.
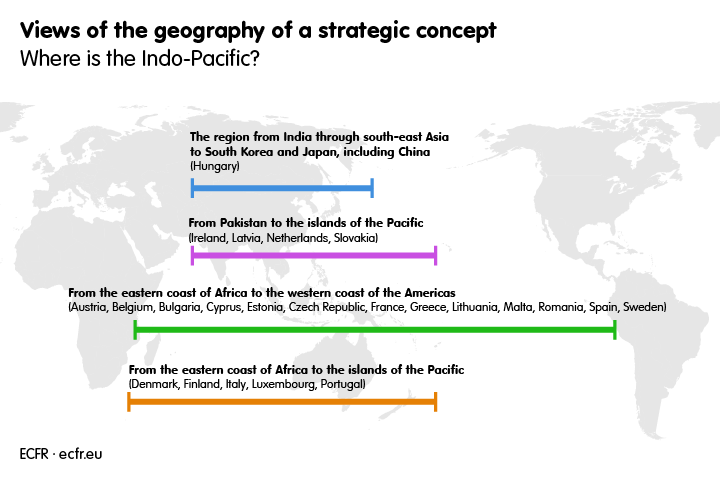
Les pays européens doivent relever beaucoup des mêmes défis que leurs partenaires dans l’Indopacifique. Et la géographie est relativement sans importance sur certaines de ces questions, comme les risques potentiels des technologies émergentes, garantir la résilience de la chaîne d’approvisionnement, contrer la désinformation et gérer la capacité croissante de la Chine à s’imposer. En conséquence, la nouvelle vision européenne de l’Indopacifique vient d’une reconnaissance politique de la nécessité d’assumer une plus grande responsabilité mondiale. Mais elle reflète également le souhait d’avoir un impact sur les affaires d’une région qui est lointaine mais dont le destin est entremêlé avec celui de l’Europe.
La portée stratégique d’une stratégie de l’UE pour l’Indopacifique
Les divisions de l’Europe quant aux modalités de l’approche de l’Indopacifique émergent clairement du sondage mené par les experts de l’ECFR. Dix des États membres de l’UE considèrent l’adoption d’une stratégie pour l’Indopacifique à la fois comme un moyen de traiter avec la Chine et comme un moyen pour l’Europe de tirer parti de nouvelles opportunités économiques et autres. Mais, pour 13 États, le concept de l’Indopacifique est simplement une aubaine pour poursuivre des intérêts économiques et le problème chinois n’occupe pas une place prépondérante. Seules les élites politiques lettones semblent considérer qu’une amélioration de la politique Indopacifique est véritablement un outil contre la Chine. Cet écart reflète la divergence d’opinions des États membres quant à savoir s’il faut prendre en considération l’Indopacifique en termes stratégiques ou en termes économiques. Comme nombre d’entre eux manquent de capacités militaires majeures, ils peuvent supposer que le changement géopolitique plus large qui est en cours est un changement qui ne peut être géré que par les plus grands États membres de l’UE ou par les Etats-Unis. Certains n’ont peut-être même pas de liens économiques solides avec la région mais peuvent supposer que ce serait le meilleur moyen de collaborer avec l’Indopacifique. Cette absence de consensus illustre bien l’ambivalence de l’Europe qui ne sait comment, voire s’il faut, élaborer une approche globale et stratégique de la région.
En ce qui concerne la façon dont la question se rapporte au partenariat transatlantique, 11 États membres considèrent l’adoption d’une stratégie de l’UE pour l’Indopacifique comme une affirmation de « l’autonomie stratégique européenne » – l’Europe faisant cavalier seul, sans avoir besoin du soutien américain. Huit estiment que c’est une façon de gérer l’alliance transatlantique – en maintenant potentiellement l’engagement des Etats-Unis étant donné que Washington est plus axé sur le Pacifique que sur l’Europe. Six pays voient le lancement d’une stratégie de l’UE pour l’Indopacifique comme faisant partie d’un effort explicite pour s’aligner avec les Etats-Unis et y sont favorables. Ces considérations ne sont pas mutuellement exclusives. Et dernièrement, la stratégie émergente n’a pas fait naître de position géopolitique claire sur les raisons pour lesquelles l’UE élabore de nouveaux plans. Même si une articulation plus claire de sa position prêterait sans aucun doute à polémique, il faudrait s’assurer que l’approche stratégique a bien une idée maîtresse qui préserve l’unité de tout le concept.
Comme fil conducteur, on peut dire que les pays européens occidentaux ont tendance à percevoir le lancement d’une stratégie pour l’Indopacifique comme une affirmation de l’autonomie stratégique, comme la République tchèque et la Slovaquie. En revanche, presque tous les pays qui voient la création d’une stratégie pour l’Indopacifique comme un signe d’alignement avec les Etats-Unis ont été par le passé membres du bloc de l’Est. La seule exception est le Portugal, mais de nombreux États classent le lancement de la stratégie pour l’Indopacifique dans plusieurs catégories. Les États européens occidentaux ont tendance à considérer la perspective d’une stratégie de l’UE pour l’Indopacifique à la fois comme un moyen de gérer l’alliance transatlantique et comme une affirmation de l’autonomie stratégique ; les États de l’Europe de l’Est estiment que c’est un moyen de gérer l’alliance transatlantique et de s’aligner avec les Etats-Unis.
Or ce positionnement géopolitique va bien au-delà de la dimension transatlantique. Lorsqu’on demande avec quels partenaires de la région, l’UE devrait travailler pour garantir le succès de sa stratégie, seulement cinq pays citent les Etats-Unis – le même nombre que ceux qui choisissent l’Inde. Même après le Brexit, le Royaume-Uni est mentionnés sept fois. Peut-être parce que plusieurs États – en particulier ceux situés en Europe de l’Est et dans la région de la mer Baltique – se reposent implicitement sur les Etats-Unis pour garantir la sécurité de leurs intérêts dans l’Indopacifique. En conséquence, ils peuvent considérer cette coopération comme acquise, mais cela pourrait également être la conséquence directe du lancement de la Integrated Review du RU seulement quelques semaines avant que le sondage ne soit mené ; le document était très focalisé sur l’Indopacifique et une cohérence d’intention qui est difficile à atteindre dans une union de 27 pays. Cette perception peut également être renforcée par les relations dues au passé colonial de la Grande-Bretagne avec d’importantes zones de la région de l’Indopacifique, donnant l’impression qu’elle est un acteur important avec qui des liens étroits sont non seulement possibles mais aussi probables.
Qui plus est, 12 États membres de l’UE citent la Chine parmi leurs trois premiers partenaires clé dans l’Indopacifique. C’est logique puisque plusieurs États européens considèrent toujours la Chine principalement comme un marché potentiel. Ceci dit, cinq pays – la Belgique, la Bulgarie, la Lettonie, le Portugal et la Roumanie – estiment également que la stratégie pour l’Indopacifique est, au moins en partie, un outil contre la Chine.
L’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN) apparaît comme la candidate la plus populaire pour la coopération dans l’Indopacifique : 21 pays partagent cette vision. Soutenir une coopération sous l’égide de l’ASEAN a un sens stratégique d’un point de vue européen parce que de solides relations avec plusieurs partenaires dans la région peuvent également appuyer la position des États membres de l’UE contre l’influence politique de la Chine. L’Europe encourage clairement une approche multilatérale de la politique étrangère – contre une approche bilatérale que préfère Pékin. Par conséquent, collaborer individuellement avec des membres de l’ASEAN tels que l’Indonésie, le Vietnam et les Philippines ne semble pas être une priorité pour la plupart des gouvernements européens. Les pays européens estiment que les autres formats multilatéraux sont nettement moins puissants – chacun n’a été cité qu’une seule fois : le Dialogue Asie-Europe (Chypre), l’Association des États riverains de l’océan indien (Italie), la Communauté des pays lusophones (Portugal) et l’Association sud-asiatique de coopération régionale et l’Initiative du Golfe du Bengale pour une coopération technique et économique multisectorielle (Suède).
L’UE et la sécurité dans l’Indopacifique
Pour l’Europe en tant que puissance commerciale, les dynamiques sécuritaires qui importent le plus dans la région Indopacifique concernent le domaine maritime. Lorsqu’ils parlent de sécurité maritime, les pays de l’UE se focalisent souvent sur la sécurité des lignes de communication maritimes. Or, le concept de sécurité maritime évolue pour couvrir bien plus que les garanties d’une traversée en toute sécurité des navires commerciaux. L’Europe a besoin de se concentrer sur la protection non seulement des voies maritimes mais également de la liberté de navigation, des zones économiques exclusives de plusieurs pays partenaires réels et potentiels, des océans, de la transmission des données via les câbles sous-marins et de la biodiversité marine.
Comme le montre le sondage de l’ECFR, 23 États membres de l’UE considèrent que la sécurité, au sens large, est une composante importante d’une stratégie UE-Indopacifique. Seuls quatre États estiment que la sécurité est secondaire dans ce genre de stratégie. Ceux qui qualifient la sécurité de « très importante » pour une stratégie de UE-Indopacifique sont situés principalement dans l’Europe de l’Est dans la région de la mer Baltique : la République tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie et la Slovaquie. L’Estonie, la Lettonie et la Roumanie établissent un lien explicite entre ce jugement et leurs relations avec les Etats-Unis. Cela est dû à l’importance qu’ils accordent aux Etats-Unis comme partenaires en général et parce qu’ils pensent que soutenir Washington dans certains domaines politiques renforcera l’engagement américain d’assurer la sécurité en Europe. Les résultats du sondage suggèrent que les élites politiques lettones pensent que les Etats-Unis devraient faire clairement partie de toute approche européenne de l’Indopacifique.
La dimension américaine est également fondamentale pour certains États qui voient la dimension sécuritaire de la stratégie de l’UE pour l’Indopacifique comme « relativement importante ». La Finlande, par exemple, fait clairement référence à l’importance de coopérer avec des pays partageant les mêmes valeurs comme les Etats-Unis. Pour la Belgique et la Bulgarie, il existe un lien indéniable entre l’essor de la Chine et la dimension sécuritaire d’une stratégie de l’UE pour l’Indopacifique. Mais il y a également des cas particuliers : le Portugal semble ne pas vouloir relier de dimension sécuritaire à des différends spécifiques inter-États, territoriaux ou maritimes. Curieusement, la France – qui est le pays de l’UE le plus engagé sur le plan militaire dans l’Indopacifique – considère la dimension sécuritaire de la stratégie de l’UE seulement « relativement importante ». Le sondage de l’ECFR suggère que cette dimension devrait uniquement compléter les propres politiques sécuritaires de la France, où la coopération avec les Etats-Unis – ainsi qu’avec l’Australie, l’Inde et le Japon – est une composante importante.
Il est intéressant de noter que le facteur américain influence également la réflexion des pays qui voient la sécurité comme secondaire pour la stratégie UE-Indopacifique. La Lituanie a peu d’intérêt sécuritaires et de moyens dans la région mais est d’accord sur le fait qu’il est important d’inclure la sécurité dans une stratégie pour l’Indopacifique – car cela pourrait permettre de maintenir l’implication des Etats-Unis en Europe. Dans l’ensemble, l’importance de la sécurité dans la stratégie de l’UE pour l’Indopacifique dépend, explicitement ou implicitement, de sa capacité à démontrer l’attachement à l’alliance avec les Etats-Unis, en sécurisant ainsi l’engagement américain en Europe. Ces considérations expliquent au moins en partie pourquoi des États dotés de capacités militaires limitées à consacrer à l’Indopacifique – la République tchèque, l’Estonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Pologne et la Slovaquie – sont d’accord pour que l’UE augmente ses investissements dans les activités de sécurité maritime dans la région. On peut se demander si cela se traduira par une véritable mobilisation des ressources de ces pays pour assurer la sécurité dans l’Indopacifique. Toutefois, le soutien politique de ces pays pourrait être utile si l’UE voulait construire une coalition d’États européens individuels, coalition qui s’engagerait à faire davantage pour défendre les intérêts européens dans la région.
Ce sondage demandait dans quels types de coopération ou de soutien en matière de sécurité les États membres aimeraient que l’UE investisse, ainsi que ceux auxquels ils seraient prêts à contribuer. Vingt et un États considèrent la cyber sécurité comme une priorité pour l’UE – plus que la sécurité maritime. Leurs perceptions pourraient partiellement s’expliquer par le fait que la sécurité maritime de l’Indopacifique ne fait peser qu’une menace directe limitée sur l’intégrité et la souveraineté territoriale européennes, tandis que les effets immédiats des cyber attaques sont déjà perceptibles en Europe même. De même, la cyber sécurité est un domaine dans lequel il pourrait y avoir une immense opportunité de non seulement renforcer les capacités de défense de l’Europe à domicile, mais également la sécurité européenne grâce à des échanges d’informations avec des partenaires dans la région qui doivent relever les mêmes défis.
L’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovaquie et la Suède disent que la lutte contre le terrorisme devrait faire partie de la dimension sécuritaire de toute stratégie à venir. Cela est peut-être dû aux attaques terroristes que ces pays ont connues par le passé sur leur territoire.
Déclarer que la sécurité est importante est une chose mais combien de pays sont prêts à joindre le geste à la parole ? Seul un nombre limité d’États membres sont d’accord pour contribuer à la sécurité maritime. Douze États sont prêts à participer à la liberté de navigation mais seules l’Allemagne et l’Espagne déclarent être prêtes à établir ou accroître leur présence militaire dans l’Indopacifique. Toutes deux son prêtes à envoyer des navires de guerre dans la région – tout comme la Belgique et les Pays-Bas. Vu le petit nombre de pays d’accord pour contribuer, il y aura peut-être une rupture entre les actions que les pays trouvent importantes et les moyens qu’ils sont prêts à mobiliser pour s’engager. Cela pourrait signifier que l’UE contribuera peu de manière active à la sécurité de l’Indopacifique. Mais cela pourrait également inciter l’UE à s’impliquer dans la sécurité de l’Indopacifique en fonction de ses capacités réelles –par exemple, en aidant les États riverains de la région à contrôler leurs zones économiques exclusives.
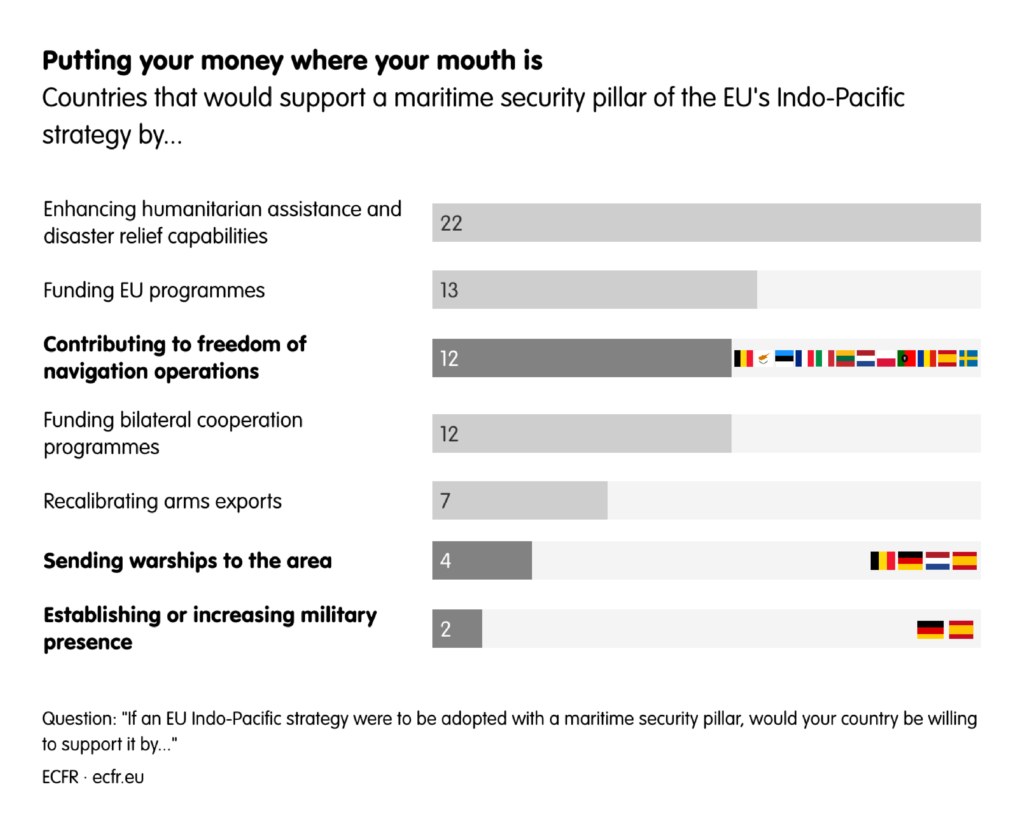
Dans ce contexte, les décideurs politiques de certains États membres mettent en lumière le lien entre sécurité maritime et soutien pour la gestion durable des océans. La gestion des zones de pêche revêt une importance particulière, étant donné que cette activité est une question économique, environnementale et – de plus en plus – géopolitique. Comme l’ont démontré les querelles territoriales de longue date entre la Chine et les pays voisins dans la mer de Chine méridionale, la gestion des zones de pêche contribue à l’évolution du paysage stratégique. Ce paysage se caractérise non seulement par un équilibre militaire des puissances – domaine où l’Europe affiche des déficits clairs qu’elle aura du mal à combler à court-terme – mais également par une combinaison de moyens pour affronter divers défis.
En incluant la question de la pêche dans une stratégie Indopacifique, l’UE rendrait non seulement justice aux intérêts européens dans ce domaine mais établirait également une présence dans une zone controversée où elle a une grande expérience. La gestion des zones de pêche est un enjeu primordial dans la région et a d’énormes implications sur la sécurité. C’est un enjeu où l’Europe peut être d’une grande utilité au-delà de sa capacité militaire et peut permettre de contribuer à la sécurité en soutenant des approches multilatérales qui sont non conflictuelles, inclusives et cohérentes avec les intérêts et valeurs de l’UE.
De même, la plupart des États membres sont prêts à contribuer à l’assistance humanitaire et aux secours en cas de catastrophe. Treize États sont d’accord pour contribuer au financement des opérations de l’UE et 12 à intervenir dans un programme de coopération bilatérale, dans ces domaines. Ces deux dernières options ne s’excluent pas mutuellement : huit pays sont d’accord pour contribuer aux programmes de coopération tant européenne que bilatérale. Cela permet de penser que l’Europe a des options lorsqu’il s’agit de collaborer avec la région – et qu’elle peut aider ses partenaires dans l’Indopacifique par le biais d’un engagement à la fois bilatéral et multilatéral selon le cas.
Les données du sondage indiquent que les États membres sont généralement favorables à un plus grand engagement européen dans la sécurité maritime de l’Indopacifique, mais que seuls quelques uns sont prêts à consacrer des moyens militaires à la protection des intérêts européens. Ils préfèrent clairement limiter leur engagement à des activités non militaires. L’UE continuera à manquer de crédibilité en matière de sécurité au sens strict (hard security) dans la région. Or, même si ses contributions non militaires ne sont pas décisives, elles pourraient toujours être une source d’aide importante pour ses partenaires dans la région étant donné qu’ils gèrent une multitude de nouveaux scenarios sécuritaires.
Diversifier les relations économiques et développer les marchés
L’Indopacifique est essentielle à la croissance mondiale. Actuellement, c’est la deuxième plus grande destination des exportations provenant de l’UE et elle abrite quatre des dix premiers partenaires commerciaux du bloc. En 2019, la région représentait plus de 40 pourcent du commerce non européen de marchandises pratiqué par l’Allemagne – chiffre qui ne pourra que s’accroître (particulièrement durant la reprise post-coronavirus). L’Inde, par exemple, est le plus grand marché mondial de données ouvertement accessibles. Et, d’ici 2025, l’Inde et l’Indonésie représenteront collectivement près de 25 pourcent des utilisateurs de données du monde.[1]
La grande majorité des États membres de l’UE voient l’Indopacifique comme une opportunité économique énorme. À une époque de rivalité croissante entre grandes puissances et d’énorme pression en matière de localisation en Chine, la diversification dans la région devient de plus en plus nécessaire face au marché chinois dominant. Cela est particulièrement vrai pour l’industrie allemande, qui est fortement liée aux marchés chinois et profondément entremêlée avec la Chine par ses chaînes d’approvisionnement. Les entreprises allemandes ont pris conscience de ce défi et sont également favorables à une diversification, en renforçant la dynamique politique au niveau de l’UE.
Comme le montre le sondage de l’ECFR, neuf États membres – Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Lituanie, Pologne, Portugal et Roumanie – considèrent que renforcer la collaboration économique avec la région fait non seulement partie d’une stratégie de diversification mais que c’est également un outil pour s’opposer à la Chine.
Dans les relations bilatérales des États membres de l’UE avec les pays de la région, les divergences d’analyses de la Chine – sur comment contraindre ou s’adapter au pays – sont actuellement moins pertinentes. Toutefois, dès que l’UE voudra agir conjointement et utiliser son influence et ses ressources collectives, ces différences pourraient créer d’importantes tensions. Ce constat vaut également pour les accords commerciaux multilatéraux inclusifs et la stratégie en matière de connectivité de l’UE souvent citée.
Connectivité
La connectivité – telle que définie par Bruxelles dans la stratégie UE-Asie en matière de connectivité – est destinée à rapprocher les pays, les peuples et les sociétés. Elle est supposée faciliter les relations économiques et personnelles. La connectivité « hard » comprend la construction d’infrastructures physiques, de systèmes de transport de l’électricité et des bases pour des transferts de données ; la connectivité « soft » quant à elle comprend les échanges entre les individus et l’harmonisation de normes réglementaires pour améliorer le commerce transfrontalier. La connectivité est l’un des domaines clés où l’UE peut renforcer la coopération et approfondir ses relations avec l’Indopacifique.
L’adoption de la stratégie de la connectivité UE-Asie par la Commission européenne en septembre 2018 a été mise au cœur de l’agenda de l’UE en pleine évolution sur l’Indopacifique. Cela a été largement interprété comme une tentative de donner aux pays de la région une alternative au projet chinois la Ceinture et la Route. Les fonctionnaires européens voient la connectivité comme un outil géopolitique qui peut permettre de promouvoir la stratégie, les intérêts et les valeurs de l’UE dans l’Indopacifique en renforçant l’autonomie stratégique de l’UE et sa capacité à agir. Mais l’ensemble des sujets qui relève de la large définition de la « connectivité » signifie aussi qu’individuellement les États membres sont souvent motivés par des priorités très différentes.
Quant on leur a demandé de décrire la nature du débat sur la connectivité, 12 États membres de l’UE ont répondu que la discussion domestique sur la question avait été rudimentaire ou inexistante. Parmi ceux qui ont signalé que des débats sur la connectivité avaient lieu dans leur pays, 11 ont déclaré qu’ils portaient sur les questions numériques et de transport, tandis que sept ont dit que leur souci principal était l’énergie – en insistant sur la connectivité « hard » qui produit des structures concrètes comme des routes, des ponts et des réseaux énergétiques. Six pays considèrent le commerce comme l’élément clé de la connectivité.
Quant on leur a demandé comment choisir les projets d’infrastructures de connectivité dans la région, 19 États ont répondu que les intérêts économiques européens devaient être la principale priorité. Cela repose sur la logique qui domine en Europe selon laquelle les projets ne doivent être financés que s’ils sont économiquement viables et durables. Cela reflète également les opportunités commerciales pour les entreprises européennes dans ce contexte. Les entreprises européennes n’ont pas joué un rôle prépondérant dans le projet chinois la Ceinture et la Route, en d’autres termes elles ont raté des parts de marché et des investissements massifs des pouvoirs publics. Seuls quatre pays ont directement signalé que lutter contre la Chine devrait être une priorité de l’offensive de l’Europe en matière de connectivité dans la région. Mais les entretiens menés par l’ECFR dans dix pays – Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne et Slovaquie – indiquaient que la Chine ou le projet chinois la Ceinture et la Route servaient au moins de toile de fond à la réflexion stratégique sur la connectivité dans la région Indopacifique.
Du commerce comme stratégie au commerce vs stratégie ?
Pendant des décennies, le commerce et les investissements ont été au cœur de l’approche européenne de l’Indopacifique et ont dominé les relations de l’Europe avec les pays de la région. L’Europe, suite à son réveil Indopacifique, souhaite-t-elle devenir un partenaire stratégique pour ces États ? Et quelle importance aura le commerce dans leurs relations ?
Les résultats du sondage indiquent que la plupart des États membres de l’UE considèrent encore principalement l’Indopacifique comme une région d’opportunité économique. Mais comme la pandémie de la Covid-19 a exposé au grand jour les risques de la mondialisation des chaînes d’approvisionnement et des marchés, les tendances à la démondialisation deviennent de plus en plus présentes sur toute la planète. Certains pays européens sont restés relativement à l’abri : le sondage de l’ECFR indique que Chypre, la République tchèque, la Grèce, l’Italie, Malte, les Pays-Bas et la Slovaquie pensent que les avantages de la mondialisation compensent son coût.
Pour autant, comme les réponses des pays le montrent dans cet article, il n’y a eu un débat sur la démondialisation que dans 19 États membres (avec des formes et des intensités différentes), lié à leur exposition au commerce international. Dans la plupart des pays, le débat a tourné autour de la manière d’équilibrer le risque d’une dépendance excessive, notamment à l’égard de la Chine, et la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement avec le risque que la démondialisation ait un impact négatif sur leurs économies, se traduisant par une perte des parts du marché mondial, d’échanges internationaux et d’emplois chez eux.
Ainsi, le sondage montre que les pays européens voient largement le débat sur la mondialisation comme la recherche de moyens pour gérer les risques et mieux équilibrer les intérêts nationaux et internationaux – en donnant lieu à des considérations sur les possibilités de moderniser les industries nationales et souvent, sur la relocalisation ou la délocalisation de proximité (nearshoring), ainsi que la « réindustrialisation » de l’Europe. Ce débat est parfois opportuniste : certains pays espèrent bénéficier de la délocalisation de proximité de la part de fabricants européens comme l’Allemagne qui pourrait décider de relocaliser ses sites de production depuis la Chine et d’autres pays asiatiques dans des pays plus proches d’elle. Dans l’ensemble, pourtant, le sondage suggère que le débat en Europe est davantage centré sur la diversification du commerce que sur la relocalisation des capacités de production. Cela est en partie dû à la difficulté de déplacer la production en dehors de la Chine. Cela est aussi dû au fait que la demande croissante en Asie du Sud et du Sud-Est signifie qu’il y aura un nombre croissant de clients à proximité des sites de production.
Ces considérations se reflètent également dans les préférences que les États membres de l’UE expriment sur les accords commerciaux potentiels entre l’UE et les pays de l’Indopacifique. Leurs vues sur la question sont particulièrement importantes dans le contexte d’une stratégie de l’UE pour l’Indopacifique, étant donné que les compétences de l’UE en matière commerciale lui permettent d’agir de manière plus unifiée que dans la plupart des autres domaines. En outre, les accords commerciaux comportent non seulement des intérêts économiques mais également des intérêts géopolitiques, puisqu’ils englobent tout un ensemble de valeurs et de normes. L’UE s’est engagée dans une vaste offensive en vue de signer des accords de libre-échange supplémentaires (ALE) dans la région Indopacifique depuis l’échec cuisant des négociations du cycle de Doha sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2008. Cela a déjà permis à l’UE de conclure des ALE avec des pays tels que le Japon, la Corée du Sud, Singapour et le Vietnam, et de négocier avec plusieurs autres, dont l’Australie et l’Indonésie. Dans le cadre de sa dernière offensive dans l’Indopacifique, l’UE a relancé les négociations avec l’Inde en 2021. Une multitude d’ALE bilatéraux cependant ne représentent que la deuxième ou troisième meilleure option. En l’absence d’une réforme de la structure de l’OMC, ces ALE servent les intérêts européens en soutenant le commerce libre et juste, tout en ajoutant de nouveaux domaines importants tels que les données et le commerce numérique au cadre réglementaire. Un ALE plus large qui engloberait de nombreux États dans l’Indopacifique – et qui harmoniserait l’environnement commercial pour les entreprises européennes actives dans la région – serait préférable à une série d‘arrangements bilatéraux. Cette entente faciliterait les affaires dans un espace géographique plus vaste et dans des environnements juridiques différents. Mais, jusqu’à présent, cela n’a pas été possible.
Dans ce sens, l’attitude des Européens face à la possibilité d’un ALE avec la Chine et l’inclusion de la Chine dans des accords commerciaux plus larges que l’UE pourrait conclure dans l’Indopacifique, illustrent bien que les États membres de l’UE sont divisés sur ces questions. Dix d’entre eux soutiennent la conclusion d’un ALE avec la Chine ou l’inclusion du pays dans un accord global. Les élites politiques d’Autriche, de Bulgarie, de Croatie, de Chypre, du Danemark, de Grèce, d’Irlande, de Malte, de Pologne et de Suède estiment que la Chine ne peut pas ou ne devrait pas être exclue des accords potentiels de commerce avec l’UE. Cependant, elles expriment une certaine ambivalence sur la question. Les hauts fonctionnaires bulgares, par exemple, craignent que la Chine sabotent un accord de commerce global en mettant la pression sur d’autres acteurs de l’Indopacifique.
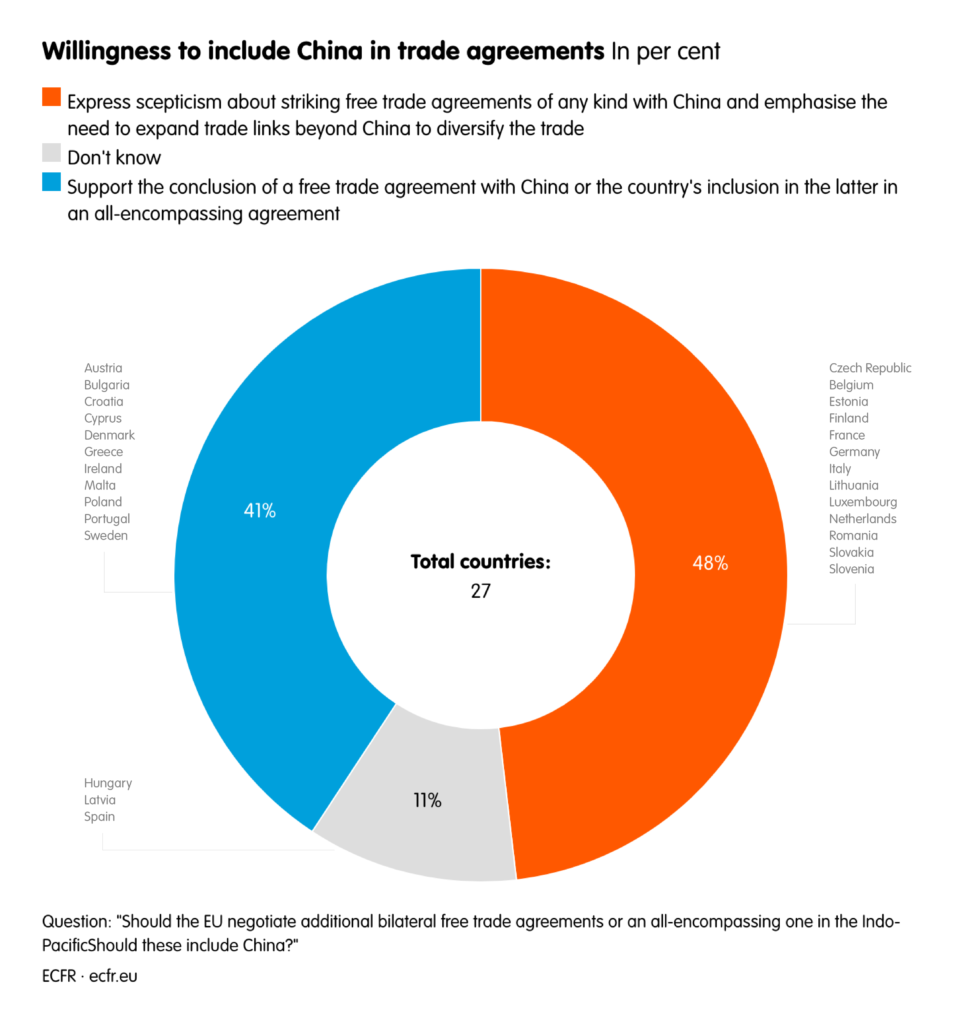
Comme on pouvait s’y attendre, cependant, le scepticisme de 14 États membres au sujet de la participation potentielle de la Chine aux accords commerciaux de l’UE reflète une ambivalence plus qu’une franche opposition de principe. En Belgique, par exemple, les principales parties prenantes pensent que le pays soutiendrait la conclusion d’un accord commercial avec la Chine à condition que Pékin respecte le droit international. Les parties prenantes de Finlande et du Portugal expriment des vues semblables, en déclarant que la Chine ne devrait pas être exclue mais devrait être tenue aux mêmes obligations que les autres. Il semble que les Pays-Bas passeraient un accord avec la Chine à condition que cette dernière adopte les normes que l’Europe intègre dans tous ses accords de libre échange – de la protection de l’environnement aux droits du travail en passant par la confidentialité des données. Les décideurs politiques allemands ne contestent pas ouvertement une relation commerciale globale avec la Chine mais insistent bien sur la nécessité d’obtenir le bon équilibre entre rivalité et partenariat. Leurs homologues français s’inquiètent quant à eux sur le plan politique, au sujet de l’inclusion de la Chine dans un futur accord commercial.
Il existe un large consensus dans les attitudes envers l’approche globale que l’UE devrait adopter. Tous les États membres sont favorables à la conclusion d’accords de libre-échange bilatéraux avec des pays tels que l’Australie, l’Indonésie, le Japon et l’Inde au lieu d’accords globaux – qui sont plus complexes, plus longs et parfois irréalistes. Onze pays considèrent l’ASEAN comme l’une des trois entités les plus importantes avec qui l’UE devrait envisager de créer un ALE. Huit classeraient les membres de l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique comme des partenaires clé. Mais même pour un pays comme l’Allemagne, qui a fait de la conclusion d’un ALE avec l’ASEAN un des objectifs de sa propre stratégie politique dans l’Indopacifique, un tel accord ne devrait être que le résultat d’un processus graduel où la création d’un réseau d’ALE serait la base d’un futur accord interrégional entre l’UE et l’ASEAN.
Le quasi-consensus des 27 États membres de l’UE sur des accords aux standards élevés risquerait d’empêcher l’UE de conclure des ALE avec des groupements de quelque nature que ce soit. Au moins 25 États membres s’accordent pour dire qu’il faut des normes environnementales fortes, des protections de la propriété intellectuelle, une législation de la concurrence et des mesures sur les subventions ou entreprises publiques. Ces préférences se reflètent déjà dans la manière avec laquelle l’UE conclut des ALE dans la région, en général en négociant avec plusieurs pays plus petits et moins développés. L’ALE entre l’UE et le Vietnam contraste avec cela. Le fait que l’UE ait été capable de conclure cet accord laisse penser que c’est la référence absolue des ALE avec une économie en développement dans la région.
Technologie
Dans ce contexte de rivalité stratégique entre les Etats-Unis et la Chine, la compétition technologique est appelée à devenir un motif de friction majeur entre les États. Plus que dans tout autre domaine, la technologie pose aux États membres de l’UE un dilemme où leur faiblesse relative est difficile à évaluer. Pour encourager une gouvernance numérique fondée sur des normes et des standards internationaux, Bruxelles devra travailler étroitement avec ses partenaires partageant les mêmes valeurs dans l’Indopacifique. L’UE a déjà admis que la région était essentielle pour les intérêts numériques de l’Europe – et il est fort probable par conséquent, qu’elle inclue la technologie dans une stratégie Indopacifique globale.
On n’observe aucune tendance perceptible dans les priorités des États membres vers la technologie. Quinze pays considèrent que la question de la 5G est importante en Europe mais seules la Suède et la Lettonie considèrent des partenariats 5G – sujet qui, ces dernières années, a été au centre des discussions européennes sur la stratégie de la connectivité – comme une priorité absolue. La coopération en matière de recherche et de développement est la première des priorités pour neuf pays et la dernière priorité pour sept autres. L’inquiétude autour de la cyber sécurité n’est pas concentrée dans une zone géographique en particulier et c’est la Croatie, la République tchèque, la Finlande et la Slovénie qui la considèrent comme une priorité absolue. Sept pays – dont le Danemark, la France, les Pays-Bas et la Slovaquie – font figurer la cyber sécurité parmi leurs deux dernières priorités de la dimension technologique de la stratégie de l’UE pour l’Indopacifique.
Conclusion
Le sondage de l’ECFR confirme le caractère crucial de la question chinoise pour les relations de l’Europe avec les pays de l’Indopacifique et l’élaboration de sa politique étrangère et économique plus largement. Pour l’UE, le réveil de l’Indopacifique a été largement suscité par la mutation des réalités et des changements géopolitiques dans ses rapports avec la Chine – ainsi que des développements à l’intérieur du pays.
L’approche stratégique à long terme de l’UE pour l’Indopacifique devra tenir compte de ces éléments moteurs. Les inquiétudes au sujet de la Chine semblent façonner toutes les opinions que les États membres ont exprimées sur les composantes potentielles de la collaboration future de l’Europe avec la région. La plupart des États membres ne sont pas énormément dépendants du commerce avec la Chine. Toutefois, le potentiel du marché chinois comme source future de croissance et de prospérité plane considérablement sur l’Europe, en altérant souvent la volonté des États membres de se positionner clairement sur des sujets politiques controversés.
Comme l’assurance croissante de la Chine et sa rivalité avec les Etats-Unis exacerbent les tensions dans l’Indopacifique, il va être de plus en plus difficile pour les Européens de rester neutres. Toutefois, les résultats du sondage laissent penser que les capitales européennes n’ont pas encore complètement compris la signification des virages stratégiques qui ont eu lieu dans la région et les conséquences qu’ils auront sur la capacité de l’Europe d’agir. Au contraire, un sentiment d’opportunité économique et la notion de neutralité stratégique l’emportent souvent parmi les États membres – comme on l’a vu dans leur immense adhésion au partenariat avec des organisations multilatérales telles que l’ASEAN.
Seuls la France, les Pays-Bas et l’Allemagne ont les capacités en matière de sécurité et la volonté de protéger les intérêts de l’Europe liés à l’état de droit et à la stabilité dans la région, ainsi que d’assurer une aide militaire aux pays qui affrontent les menaces croissantes qui pèsent sur leur souveraineté territoriale et économique. D’autres pays européens (en particulier les États Baltes) reconnaissent qu’il existe des défis liés à la sécurité dans l’Indopacifique mais qu’ils ne sont guère en mesure de les relever de manière significative.
Les leaders des États membres et les échelons supérieurs de l’UE sont de plus en plus conscients qu’une plus grande collaboration stratégique avec l’Indopacifique est indispensable pour définir le rôle de l’Europe dans le monde mais la plupart d’entre eux essayent actuellement de le faire à moindre coût. Quelques uns sont prêts à pousser cette logique jusqu’à sa conclusion. Dans ce contexte, de nombreuses capitales européennes conçoivent l’autonomie stratégique comme une assertion de neutralité – la possibilité de ne pas avoir à choisir entre les Etats-Unis ou la Chine – et non comme un moyen de tirer parti de la puissance collective des partenaires stratégiques de l’Europe et de participer activement à la prise de décisions et à l’environnement politique.
Cela est évident sur des questions telles que la connectivité pour laquelle il n’existe pas d’ensemble de critères précis pour lancer, administrer et financer des projets identifiés par les États membres de l’UE. La plupart des États membres préfèrent une approche purement économique à une approche stratégique. Cette approche, qui est dans la droite ligne des intérêts commerciaux de certaines entreprises européennes, pourrait créer une politique pour promouvoir une croissance verte et durable, ainsi que les droits des travailleurs et d’autres formes d’élaboration de normes européennes. Les mêmes facteurs qui ont gêné la stratégie UE-Asie en matière de connectivité pourraient garantir que cette question est sans rapport avec l’approche globale européenne de l’Indopacifique – si une absence de résultats mesurables, comme des projets de connectivité visibles, convainc des tiers qu’il n’y a aucune raison d’adopter des normes et des standards européens.
La même confusion stratégique l’emporte sur pratiquement tous les sujets, y compris la technologie et le commerce. Dans les deux cas, le défi créé par l’essor de la Chine devient plus clair mais l’UE doit encore adopter une approche plus ferme à l’égard de l’Indopacifique ou clairement prioriser ses partenaires dans la région.
Enfin, il existe un risque réel que l’approche stratégique européenne de l’Indopacifique ne soit rien d’autre qu’une série de principes sans aucune substance véritable pour les appuyer. Cela n’enverrait aucun message politique réel ni aux amis et ni aux ennemis.
Dans un avenir proche, l’UE devra peut-être encore adopter une approche prudente avec la région, pour s’assurer que son engagement reste proportionné à l’évolution de ses capacités. Or, le nouveau paysage stratégique fait qu’il est de plus en plus clair que la neutralité n’est plus une option. L’UE et ses États membres devront admettre leurs différences avec la Chine même plus directement qu’ils ne le font déjà.
Dans le contexte actuel, il est peu probable que tous les États membres s’accordent sur un seul concept de l’Indopacifique et, par conséquent, élaborent des politiques communes et cohérentes sur toutes ses composantes. Au lieu de cela, les États membres de l’UE devraient adopter une approche qui utilise la stratégie de l’UE pour l’Indopacifique à venir comme un cadre où élaborer des politiques qui seront mises en œuvre par diverses coalitions européennes. Cela pourrait renforcer la capacité des Européens à agir, à accroître la visibilité de l’Europe dans la région et à souligner la volonté de l’UE de jouer un rôle actif en structurant la dynamique géopolitique émergente.
La création d’une stratégie pour l’Indopacifique est une avancée remarquable pour l’UE et la plupart des États membres – mais cela reste un effort autocentré. L’Europe devrait travailler plus étroitement avec les pays de l’Indopacifique pour structurer son approche à plus long-terme. Il sera indispensable pour l’Europe de comprendre les diverses attentes de ses partenaires dans l’Indopacifique. Faire connaître et faire comprendre ses attentes relève de la responsabilité des partenaires eux-mêmes. Un processus de consultation institutionnalisé pourrait aider l’UE à passer de la stratégie – qui sert de point de départ à une nouvelle approche – à une mise en œuvre efficace et mutuellement bénéfique. Les partenariats connectivité de l’UE avec l’Inde et le Japon montrent comment un dialogue institutionnel, s’il est bien mené, peut conduire à un réel changement et peut donner à l’Europe davantage de visibilité et de poids politique dans l’Indopacifique.
Il serait irréaliste d’attendre des 27 États membres qu’ils s’engagent soudainement sur des questions telles que la sécurité maritime, par exemple, alors qu’ils manquent de capitaux pour le faire (et acquérir ces capitaux leur prendrait des années de développement soutenu et d’investissements). Or les pays européens peuvent se concentrer sur des contributions très demandées, même si elles sont légèrement plus ciblées, dans la mesure de leurs moyens – la gestion des zones de pêche étant un exemple parfait.
Avoir des capacités limitées ne peut plus servir d’excuse à l’inaction. Le développement d’une stratégie efficace dans l’Indopacifique prendra des années ; l’Europe n’examinera pas tous les sujets au même rythme mais les Européens n’ont plus le luxe d’ignorer ces défis. L’adoption d’une stratégie pour l’Indopacifique est dictée par la nécessité. Ce n’est pas un choix entre confrontation ou arrangement vis-à-vis de la Chine. C’est un choix entre le bon équilibre des relations avec la Chine ou la capitulation – entre s’affirmer sur la scène internationale ou devenir inutile.
Les Européens seraient bien avisés de regarder les contraintes stratégiques de certains de leurs principaux partenaires économiques et stratégiques dans l’Indopacifique, notamment l’Australie, l’Inde et le Japon. Tous ces pays sont davantage dépendants économiquement de la Chine et sont bien plus menacés en raison de leur proximité géographique. Aucun d’eux ne peut se permettre de provoquer Pékin mais ils savent tous que la complaisance n’est pas une solution. Chacun d’eux a développé une stratégie pour l’Indopacifique pour équilibrer la nécessité économique et les impératifs de la sécurité. Aucun d’eux n’est mieux placé que l’Europe. Mais, de la même manière, aucun ne considère l’hégémonie de la Chine comme inévitable. Tous conservent un certain niveau de collaboration économique et politique avec la Chine tout en cherchant des garanties de sécurité dans leur partenariat respectif avec les Etats-Unis et, de plus en plus, en construisant des coalitions les uns avec les autres. En conséquence, il serait opportun de discuter de la mise en place de la stratégie à venir de l’UE avec chacun d’eux.
Enfin, le processus de développement d’une stratégie de l’UE pour l’Indopacifique a été intrinsèquement précieux. Il a déclenché un débat en Europe au-delà de la France, de l’Allemagne et des Pays-Bas et de ce fait l’Indopacifique figure en bonne place de l’agenda européen. Il est raisonnable de s’attendre à ce que le processus qui consiste à faire avancer cette stratégie contribuera à mieux sensibiliser l’Europe à la dynamique et à l’importance de l’Indopacifique – et à créer un nouvel état d’esprit qui pourrait conduire à des politiques plus cohérentes et marquantes. Alors que l’Europe abandonne progressivement une politique naïve vis-à-vis de la Chine, ce pourrait être une occasion historique de concrétiser le potentiel d’une approche pan-européenne de l’Indopacifique.
Analyses par pays
Allemagne
Vision de l’Indopacifique
En Allemagne, c’est le ministère des Affaires étrangères qui mène le débat sur l’Indopacifique, qu’il considère comme une question allant au-delà des simples termes géographiques. La définition de Berlin de l’Indopacifique englobe tout ce que recouvrent l’océan Indien et l’océan Pacifique. Pour l’Allemagne, une approche européenne de la région est vitale afin de défendre les intérêts économiques de l’UE et de lutter contre les menaces régionales qui pèsent sur les intérêts stratégiques de l’UE et la coercition économique mais également pour discuter du changement climatique et d’autres considérations environnementales.
Indopacifique : stratégie de l’UE
D’un point de vue géostratégique, l’Allemagne voit la future stratégie de l’UE comme une opportunité pour l’UE et comme un moyen de faire face à l’ascension de la Chine plutôt que comme une mesure d’endiguement. Cela a été mis en exergue par la décision de Berlin d’appeler sa vision nationale de l’Indopacifique, « orientations politiques » plutôt que « stratégie ». Dans ce contexte, la vision de l’Allemagne de l’Indopacifique est une vision visant à s’opposer à l’hégémonie chinoise mais sans prendre parti dans la compétition qui existe entre les États-Unis et la Chine. Au vu de ces considérations, l’Allemagne aimerait que l’Union européenne renforce ses liens avec le Japon, l’Inde et le Royaume-Uni, et approfondisse les partenariats avec la Nouvelle-Zélande et l’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN).
Sécurité européenne
L’Allemagne estime que les considérations en matière de sécurité dans l’Indopacifique sont tout aussi importantes, surtout sur le fond des tensions dans la Mer de Chine méridionale et le détroit de Taiwan, qui pourraient miner la stabilité globale de la région. Ceci étant dit, l’Allemagne apprécierait que l’engagement sécuritaire de l’UE soit davantage orienté vers des problèmes de sécurité non-traditionnels : elle pense que la puissance réglementaire de l’UE devrait être employée pour promouvoir une bonne gouvernance, une politique climatique et un ordre fondé sur des règles dans la région. Les activités maritimes durables seraient également appréciées en vue de promouvoir des actions éclairées en fonction du climat, même si cela n’est pas l’intérêt premier de l’Allemagne.
Développement économique
Même si élargir la portée de son engagement politique dans la région redevient important, l’approche de l’Allemagne à l’égard de l’Indopacifique est encore axée sur le commerce, les investissements et la sécurité économique. Berlin espère que de solides relations commerciales avec plusieurs partenaires de la région pourraient également renforcer leur souveraineté contre l’influence politique que Pékin exerce par le biais de son projet la Ceinture et la Route. À cet égard, la connectivité fait l’objet de discussions animées en interne en Allemagne, en particulier en ce qui concerne la mobilité durable. La connectivité est vue comme la clé de la réussite sur les concurrents à l’échelle internationale. Dans ce contexte, Berlin pense qu’il est important de permettre une concurrence loyale, d’éviter un surendettement des pays bénéficiaires et de garantir la durabilité et la transparence des projets. Berlin pense par conséquent que le financement des projets de connectivité dans la région indopacifique devrait provenir de plusieurs sources, à savoir des institutions financières internationales, des banques multilatérales de développement, du secteur privé et de la Banque européenne d’investissement. Berlin voit la connectivité comme une plateforme pour développer les échanges entres les peuples et améliorer l’infrastructure des transports, dont les normes devraient être convenues de manière multilatérale, y compris par le biais des Principes du G20 sur les Investissements dans des infrastructures de qualité. Tout en pensant que les intérêts économiques devraient l’emporter lorsque l’UE décide quels projets d’infrastructure de connectivité prioriser, Berlin aimerait également voir un rééquilibrage des relations de l’UE avec la Chine dans le but de réduire la dépendance de la première vis-à-vis de cette dernière.
L’Allemagne serait favorable à la diversification économique en vue de réduire les vulnérabilités européennes et de poursuivre une politique étrangère plus autonome. Elle serait par conséquent ouverte à de nouveaux accords de libre-échange bilatéraux dans toute la région pour réduire sa dépendance actuelle à l’égard de la Chine. Elle serait donc heureuse de renforcer les liens bilatéraux avec les pays de cette région, en particulier en Océanie. La gouvernance des données, les partenariats 5G et la cyber sécurité sont les priorités de l’Allemagne dans le domaine technologique, ainsi que les technologies vertes pour l’industrie 4.0, telles que les véhicules électriques, les technologies de stockage et la fabrication de puces.
Autriche
Vision de l’Indopacifique
La politique Indopacifique de l’Autriche est menée par sa chancellerie fédérale qui considère l’objectif d’une stratégie européenne commune dans la région comme quelque chose un tant soit peu important pour sa défense et ses objectifs en matière de politique étrangère. La chancellerie considère que cette stratégie est non seulement l’occasion de sauvegarder les intérêts européens dans la région mais également un outil contre la Chine. Pour Vienne, la stratégie de l’Union européenne pour l’Indopacifique devrait être animée par l’affirmation d’une autonomie stratégique européenne visant à protéger les intérêts économiques de l’UE, à répondre à la coercition de rivaux systémiques et à promouvoir la durabilité environnementale. À cet effet, du point de vue de Vienne, l’Indopacifique englobe toute la région, jusqu’à la côte Ouest des Amériques.
Indopacifique : stratégie de l’UE
Vienne est favorable à l’adoption par l’UE d’une stratégie Indopacifique comme moyen non seulement pour protéger les intérêts européens dans la région mais également pour contenir Pékin. L’Autriche met généralement en avant la coopération avec des nations démocratiques, en donnant la priorité aux partenariats avec la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon plutôt qu’avec la Chine. Les exceptions sont l’Australie, qui n’est pas une priorité, et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN/ANASE) – qui est une priorité mais qui contient un mélange de pays démocratiques et autoritaires.
Sécurité européenne
La sécurité joue un rôle crucial dans la collaboration de l’Autriche avec l’Indopacifique, notamment en ce qui concerne la sécurité des chaînes d’approvisionnement – qui ont été gravement touchées par la pandémie de Covid-19 – et la liberté de navigation. Dans ce contexte, Vienne est d’accord pour investir dans la cyber sécurité, la lutte contre le terrorisme, la gestion de crises et la médiation des conflits. En tant que pays enclavé, l’Autriche accorde une importance limitée à la gestion durable des zones de pêche et au développement durable maritime. Néanmoins, si la stratégie Indopacifique de l’UE devait inclure un pilier sur la sécurité maritime, l’Autriche apprécierait une approche axée sur l’assistance humanitaire et les secours en cas de catastrophe, ainsi que sur le financement de programmes de coopération, qu’elle pourrait mettre en place au niveau bilatéral et par le biais de l’UE.
Développement économique
L’Autriche considère que la connectivité est principalement un instrument d’influence et de coercition, tout en faisant partie du développement. Par ailleurs, le débat public autrichien sur la connectivité privilégie la création d’infrastructures numériques et de transport, et porte en particulier sur l’énergie et le transport, la connectivité numérique, les chaînes d’approvisionnement, le capital humain et les efforts visant à contrebalancer l’influence de la Chine. De ce point de vue, la mise en place de normes multilatérales pour des investissements dans des infrastructures de qualité devrait être régulée par les Principes du G20 en matière d’investissements dans des infrastructures de qualité et gérée par des organisations internationales à Vienne. Le financement de projets de connectivité devrait émaner essentiellement de pays de la région et de l’UE. En ce qui concerne la technologie, l’Autriche considère la gouvernance des données et la cyber sécurité comme la première priorité, et est relativement indifférente à l’égard de l’avenir de la main d’œuvre, de la recherche et du développement.
Même si Vienne reste sur ses gardes vis-à-vis des accords de libre-échange (ALE) en général, elle préfèrerait un ALE bilatéral entre Bruxelles et Pékin au lieu d’un accord global dans l’Indopacifique. À l’échelle nationale, les discussions sur la nécessité d’établir un cadre juridique pour la diversification des chaînes d’approvisionnement sont menées par les citoyens – notamment sur les normes environnementales, que les Autrichiens qualifient de « très importantes » parallèlement à la protection du climat, aux normes sociales, à la concurrence loyale et aux règlementations sur les subventions et les entreprises publiques.
Belgique
Vision de l’Indopacifique
En Belgique, les discussions sur l’Indopacifique sont menées par le ministère des Affaires étrangères qui considère que l’objectif d’une approche européenne commune à l’égard de la région est modérément adapté à la poursuite de sa politique étrangère et de défense. Le gouvernement belge estime que l’Indopacifique s’étend de la côte orientale de l’Afrique à la côte occidentale des Amériques, et pense que l’UE devrait protéger ses intérêts économiques dans la région.
Indopacifique : stratégie de l’UE
La Belgique voit l’adoption d’une stratégie Indopacifique de l’UE comme l’occasion de gérer l’alliance transatlantique et d’élaborer un outil stratégique contre la Chine. Le gouvernement belge pense qu’il vaut mieux garder ses amis près de soi et ses ennemis encore plus près – en ce sens qu’une collaboration active avec la Chine permettrait de surveiller de près l’ascension du pays. La Belgique souhaite nouer des partenariats clé avec des démocraties dans l’Indopacifique, y compris avec les États-Unis, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et l’Australie.
Sécurité européenne
La Belgique considère que les opérations de sécurité dans l’Indopacifique ne sont que peu importantes, en particulier en ce qui concerne la Chine. L’approche plurielle du gouvernement belge à l’égard de Pékin est guidée par sa méfiance face au réveil de la Chine (qui a été exacerbé par la pandémie) ; une sensibilisation aux questions telles que l’espionnage chinois et les menaces pesant sur la liberté de navigation ; et un désir de ne pas s’aliéner la Chine dont l’aide est vitale politiquement dans de nombreux domaines, de la diplomatie avec la Corée du Sud au changement climatique en passant par le commerce. Dans l’Indopacifique plus généralement, la Belgique est favorable à l’augmentation des investissements européens dans la sécurité maritime, cyber et environnementale ; dans la gestion de crise et dans la médiation des conflits ; dans la liberté de navigation ; dans l’assistance humanitaire et dans les secours en cas de catastrophe ; dans le déploiement des navires de guerre et dans le développement durable des ressources marines dans le cadre de la protection du climat. Le pays aimerait également rectifier les exportations d’armes européennes.
Développement économique
Le débat public en Belgique porte rarement sur la stratégie de connectivité de l’UE mais, lorsque c’est le cas, il le formule en termes de mesures visant à contenir un Pékin de plus en plus menaçant. Le gouvernement belge souhaite que la stratégie serve de contrepoids au projet chinois la Ceinture et la Route, favorise les exportations nationales et de l’UE et soutienne le développement durable. La Belgique aimerait que les Européens poursuivent ces objectifs en les finançant à partir de plusieurs sources mais en mettant l’accent sur l’UE. Elle pense que l’approche de l’Europe à l’égard de l’Indopacifique devrait se concentrer sur les technologies numériques clés, puis sur les infrastructures de transport – en se focalisant sur des projets servant les intérêts économiques européens – et sur le changement climatique. Considérant l’Indopacifique comme la région la plus dynamique du monde, la Belgique croit que l’Europe devrait faire particulièrement attention à la recherche et au développement, ainsi qu’à la cyber sécurité et à la gouvernance des données. Le pays est ouvert à la concurrence sur l’équipement 5G mais fera preuve de prudence au moment d’équiper des secteurs sensibles avec cette technologie.
Des événements récents tels que la pandémie et l’accident qui a bloqué le Canal de Suez ont suscité un débat en Belgique au sujet de la nécessité de la relocalisation et de la réindustrialisation de l’Europe. Compte tenu de la dépendance de l’économie belge à l’égard des exportations, ces débats risquent de s’essouffler. Dans ce contexte, la Belgique accepterait des accords bilatéraux de libre-échange avec des États démocratiques de la région mais aurait de sérieuses réserves quant à un accord de ce type avec la Chine.
Bulgarie
Vision de l’Indopacifique
Le débat public de la Bulgarie sur l’Indopacifique se limite au travail des entités non-gouvernementales et des experts indépendants, souvent dans le contexte plus large de l’approche de l’UE des tensions Etats-Unis-Chine. En conséquence, Sofia apprécierait une stratégie favorisant un dialogue européen commun avec la région – qu’elle estime s’étendre de la côte orientale de l’Afrique à la côte occidentale des Amériques – en tenant compte des intérêts économiques, des menaces régionales à l’égard des intérêts stratégiques de l’UE et de l’environnement.
Indopacifique : stratégie de l’UE
La Bulgarie considère que la stratégie Indopacifique de l’UE assure deux ouvertures à l’Europe : un outil stratégique contre la Chine d’une part et un moyen de gérer l’alliance transatlantique. Sofia pense qu’il est relativement important de renforcer les liens avec les pays démocratiques de la région et apprécierait une plus grande coopération avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN/ANASE) et ses États membres – surtout dans le contexte des négociations UE-ASEAN sur un accord de libre-échange. La Bulgarie considère le Royaume-Uni, la Chine et le Japon comme les partenaires clé de l’UE dans la région.
Sécurité européenne
La Bulgarie apprécierait que l’UE joue un rôle sécuritaire dans l’Indopacifique uniquement s’il était contrebalancé par un effort équivalent en termes de coopération. Sofia veut éviter les critiques liées à la nature potentiellement antagoniste de la stratégie, en particulier en ce qui concerne les intérêts chinois dans la région. Ceci étant dit, Sofia serait favorable à une approche globale de la sécurité, y compris de l’aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe si la stratégie incluait la sécurité maritime. Si cela était le cas, le développement durable des ressources marines dans des domaines tels que la gestion des zones de pêches serait par ailleurs marginale pour la Bulgarie – qui lancerait peu probablement ses propres programmes sur cette question mais pourrait soutenir ceux de l’UE.
Développement économique
Les Bulgares discutent activement des manières d’améliorer les infrastructures de connectivité interne, non pas en lien avec l’Indopacifique mais dans le but de donner toute sa mesure à l’activité économique dans les Balkans. Ils s’intéressent beaucoup à la diversification des infrastructures énergétiques, ainsi qu’à la connectivité numérique étant donné que la Bulgarie est membre du programme Clean Network (réseau propre) et participe au déploiement de la 5G. Sofia voit la connectivité principalement en termes de commerce et, par conséquent, la stratégie Indopacifique de l’UE comme un élément essentiel de l’accès au marché et de la politique de développement. Il manque encore à la Bulgarie une discussion sur la mise en place des normes multilatérales pour des investissements dans des infrastructures de qualité qui devraient reposer sur la mobilisation d’une combinaison de sources, y compris un financement bilatéral avec les pays concernés de la région, une participation de la Banque d’investissement européenne et des donateurs multilatéraux. Les priorités de la Bulgarie pour l’UE sont le transport, les infrastructures numériques, la gouvernance des données, la cyber sécurité et les partenariats 5G. Le pays espère dynamiser les intérêts économiques et sécuritaires de l’UE dans l’Indopacifique tout en offrant des opportunités de développement en fonction des besoins aux pays de la région – en phase avec l’importance traditionnellement accordée par le Bloc à l’économie au lieu de la puissance militaire. Sofia a suivi attentivement le débat européen sur le besoin de diversification et de relocalisation, espérant attirer des investissements étrangers directs. À cet égard, la Bulgarie ne serait pas très enthousiaste à l’idée d’un accord de libre-échange régional – en particulier un accord qui a adopté une large définition de l’Indopacifique.
Croatie
Vision de l’Indopacifique
En Croatie, les débats au sujet de l’Indopacifique sont menés par le ministre des Affaires étrangères mais l’agenda pour une approche européenne commune à l’égard de la région n’est pas actuellement considéré comme particulièrement important. Sur la question d’une définition géographique de l’Indopacifique, la Croatie s’aligne avec la formulation du Conseil qui estime que l’Indopacifique s’étend de la côte orientale de l’Afrique jusqu’aux Îles du Pacifique. Zagreb maintient que les critères que l’UE devrait utiliser pour élaborer une définition opérationnelle de l’Indopacifique devraient être les intérêts économiques de l’UE ainsi que la coercition économique exercée par des rivaux systémiques.
Indopacifique : stratégie de l’UE
Zagreb comprend que la stratégie de l’Indopacifique est à la fois une opportunité pour l’Europe et un outil stratégique contre la Chine ; et voit dans la stratégie un alignement avec les États-Unis. En conséquence, en établissant des partenariats régionaux, la Croatie donnerait la priorité à la poursuite de relations avec des partenaires traditionnels comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et le Japon. Coopérer avec l’Inde, l’un des pays les plus grands, les plus peuplés et les plus influents au monde, et le rival de Pékin dans la région, serait également bienvenu. En outre, les partenaires à prendre en considération seraient l’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN), l’Indonésie, les Îles du Pacifique et le Vietnam.
Sécurité européenne
La Croatie est favorable au renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité de l’UE, y compris l’Indopacifique et pense que l’UE devrait investir dans les domaines de la cyber sécurité, de la lutte contre le terrorisme, de la gestion des crises et de la médiation des conflits. Si la stratégie comportait un volet sécuritaire maritime, alors Zagreb serait d’accord pour la soutenir en intensifiant l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe. La Croatie estime que tout plan stratégique futur devrait inclure une composante du développement durable mais pour l’instant elle n’a pas encore discuté de la manière d’y parvenir, tout comme pour la gestion des zones de pêche, que Zagreb aimerait bien soutenir en prônant l’adoption et le respect de règles et de normes via des canaux diplomatiques.
Développement économique
Le débat sur la connectivité reste pertinent à l’échelle nationale, étant donné que la Croatie travaille actuellement sur ses propres problèmes internes liés aux infrastructures de connectivité mais aucune discussion majeure n’est en cours au sujet de la région Indopacifique en tant que telle. Par ailleurs, tout en étant limitée, une discussion sur la mise en place de normes multilatérales concerne l’Initiative des trois mers, où la stratégie est largement considérée comme essentielle à l’accès au marché et comme faisant partie de la politique de développement. En 2019, le Premier ministre croate, Andrej Plenkovic, a déclaré : « une meilleure connectivité signifie une infrastructure de données plus sûre et de grande qualité, grâce à l’établissement d’un marché unique numérique fonctionnel et à la réduction de la fracture numérique entre les régions les plus développées et les moins développées, et à la création de conditions pour un passage aux réseaux 5G en toute sécurité ». Quant à la provenance du financement, la Croatie n’as pas encore pris position. Cependant, elle maintient que le critère de priorisation devrait reposer sur les intérêts économiques de l’UE. La pandémie de Covid-19 et l’incident du blocage du canal de Suez par le navire Ever Given ont déclenché un débat autour de la relocalisation et de la diversification des chaînes d’approvisionnement, qui n’ont pas encore d’orientation définitive en termes politiques. Ceci étant dit, la Croatie serait favorable à l’établissement de nouveaux accords bilatéraux de libre-échange dans la région et également probablement à la ratification de l’accord global sur les investissements avec la Chine. Dans cet effort, la Croatie considèrerait l’Australie et la Nouvelle-Zélande comme des partenaires clé dans la région sur la base des liens existant avec la diaspora.
Chypre
Vision de l’Indopacifique
À Chypre, les discussions relatives à l’Indopacifique sont menées par le ministère des Affaires étrangères qui considère la possibilité d’une approche de l’UE à l’égard de cette région comme modérément pertinente pour ses objectifs de défense et de politique étrangère. Pour ce pays, l’Indopacifique est une entité géographique qui s’étend de la côte orientale de l’Afrique à la côte occidentale des Amériques. En ce qui concerne la concrétisation de cette stratégie, les intérêts économiques de l’UE, les menaces régionales envers les intérêts stratégiques de l’UE et les considérations environnementales sont autant de variables que Nicosie aimerait voir prises en compte.
Indopacifique : stratégie de l’UE
Chypre voit l’Indopacifique comme une aubaine pour l’Europe. Ainsi, l’adoption d’une stratégie commune européenne serait comprise comme une affirmation de l’autonomie stratégique de l’Europe. Comme Chypre considère que le caractère démocratique des éventuels partenaires et très important, elle maintient que les principaux partenaires de l’Europe dans la région devraient être le Japon, la Corée du Sud et l’Australie. L’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN) et la Rencontre Asie-Europe (ASEM) devraient également être associées.
Sécurité européenne
En tant que pays de l’Est de la Méditerranée proche des zones de conflits, Chypre accorde une grande attention à la dimension sécuritaire de la politique étrangère de l’UE. Dans le prolongement de cette position, Nicosie souscrirait à une stratégie européenne axée sur la sécurité dans les domaines maritime et cyber, la lutte contre le terrorisme, la gestion de crises et la médiation des conflits. Ainsi, elle contribuerait à la liberté de navigation, au renforcement de l’aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe et au financement des programmes de l’UE. Étant étroitement dépendant des activités maritimes pour sa résilience économique, Chypre considère la durabilité des ressources marines comme une priorité et accorde une certaine importance à la gestion des zones de pêche : le pays est déjà membre de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée et soutiendrait volontiers des formats semblables dans l’Indopacifique.
Développement économique
La discussion sur la connectivité est à l’heure actuelle à un niveau rudimentaire et est surtout tournée vers Chypre qui espère pouvoir bénéficier de la prochaine stratégie de l’UE en termes de création et d’amélioration des infrastructures de connectivité pour la 5G qui devrait attirer davantage d’investissements. De plus, il y a débat sur la mise en place des normes multilatérales relatives aux investissements dans des infrastructures de qualité, pas seulement limitée aux Principes du G20 en matière d’investissements dans les Infrastructures de qualité, mais pour explorer différentes possibilités afin d’attirer des investissements dans des infrastructures de qualité. Chypre considère qu’une meilleure connectivité est une occasion d’attirer davantage d’investissements dans le pays ; en d’autres termes, Chypre pense que c’est un élément fondamental de la politique de développement. En ce qui concerne le financement des infrastructures dans le cadre d’une future stratégie UE-Indopacifique, Chypre prônerait la mobilisation de capitaux provenant de donateurs internationaux au lieu de compter uniquement sur le financement de l’UE. À cet égard, Chypre maintient que le moteur de l’agenda de l’UE en matière de connectivité devrait être l’intérêt économique, avec l’établissement d’infrastructures numériques en toute priorité. La discussion sur la démondialisation a largement été fomentée par ELAM, parti eurosceptique qui critique les politiques d’immigration de l’UE mais le débat ne porte pas sur la question des interdépendances économiques avec d’autres pays. Le débat sur la nécessité de diversifier et de relocaliser de l’approvisionnement en est toujours au stade embryonnaire et se préoccupe principalement d’atteindre les objectifs de développement durable pour donner davantage d’opportunités aux nations en développement. Chypre serait favorable à l’établissement d’accords de libre-échange bilatéraux individuels, y compris avec la Chine. Les partenaires que Chypre souhaiterait voir sont essentiellement l’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN), les États-Unis et la Chine. Enfin, dans le domaine numérique, Chypre voudrait surtout donner la priorité à la coopération en matière de recherche et de développement, à des considérations sur l’avenir du travail et de la main d’œuvre et à la cyber sécurité.
Danemark
Vision de l’Indopacifique
La discussion sur l’Indopacifique est menée par le ministère des Affaires étrangères, qui considère que la région est vitale pour sa défense et ses objectifs de politique étrangère. Sur le plan géographique le Danemark définit la région comme s’étendant de la côte orientale de l’Afrique jusqu’aux Îles du Pacifique. Le gouvernement maintient que la future stratégie devrait être guidée par les intérêts économiques et stratégiques de l’UE.
Indopacifique : stratégie de l’UE
Le Danemark considère l’Indopacifique comme une aubaine où la mise en place d’une stratégie de l’UE créerait une possibilité d’affirmation de soi ainsi qu’un moyen d’appuyer l’alliance transatlantique. Dans cette entreprise, le Danemark aimerait établir des partenariats avec des acteurs pertinents dans ce domaine, comme l’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN), l’Inde, le Japon, l’Indonésie et Singapour.
Sécurité européenne
La dimension sécuritaire de la stratégie indopacifique serait importante pour le Danemark – en particulier dans le domaine de la sécurité maritime, de la cyber sécurité et de la lutte contre le terrorisme ; mais ce n’est pas une priorité. Pour Copenhague il est trop tôt pour établir comment le pays pourrait contribuer à l’aspect sécuritaire maritime de la stratégie, à cause de l’existence du retrait (opt-out) national danois qui empêche Copenhague de participer à toutes les activités de la Politique de sécurité et de défense commune de l’UE qui ont des implications dans la défense. Ni les activités liées à la durabilité des ressources marines, ni la gestion des zones de pêche dans l’Indopacifique sont particulièrement importantes pour le Danemark.
Développement économique
Même s’il n’y a pas de grandes discussions au sujet de la connectivité dans le débat public danois, la question est devenue de plus en plus importante pour le gouvernement danois, notamment dans les ministères axés sur l’international. Par ailleurs, une discussion est en cours sur la nécessité de mettre en place des normes multilatérales visant à assurer des investissements dans des infrastructures de qualité. Le gouvernement pense que cela devrait être animé par les Principes du G20 sur les investissements dans des infrastructures de qualité, surtout pour s’assurer que les principaux acteurs comme la Chine, les respectent bien. Une partie de fonds publics a déjà été allouée précisément à la connectivité mais le Danemark maintient que les projets en matière de connectivité dans la région indopacifique ne peuvent aboutir que s’ils reposent sur une large gamme de financements. En ce qui concerne les priorités de la connectivité que l’UE devrait poursuivre dans la région, le Danemark privilégierait les infrastructures numériques comme aspect le plus urgent, suivies par l’énergie et le changement climatique et les infrastructures de transport. Enfin, les principaux moteurs pour déterminer la priorité des projets de connectivité devraient être les intérêts stratégiques et les considérations géopolitiques. Les discussions sur la diversification et la relocalisation des chaînes d’approvisionnement sont en cours au Danemark et portent essentiellement sur les infrastructures numériques. Plus généralement, les questions sur la démondialisation dans le pays sont guidées par la régionalisation comme solution potentielle pour faire face à certains points faibles de la mondialisation. Le Danemark est très favorable aux accords de libre-échange bilatéraux et serait heureux que l’UE en signe un même avec la Chine. Bien que ce soit irréaliste, le Danemark serait favorable à l’extension d’un tel accord à la région au sens large. En établissant une coopération avec les acteurs régionaux, le Danemark donnerait la priorité à des partenariats avec les pays de l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (TPP11), l’Inde et l’Indonésie, et considèrerait Singapour comme particulièrement important. En ce qui concerne la dimension technique, Copenhague donnerait priorité à l’établissement de projets relatifs à la recherche et au développement, à une utilisation responsable de l’IA et à la cyber sécurité.
Espagne
Vision de l’Indopacifique
La politique espagnole envers l’Indopacifique est largement centrée sur le maintien en Europe d’une autonomie stratégique indépendante. Le ministère des Affaires étrangères dirige les discussions espagnoles sur les questions liées à l’Indopacifique et considère qu’une approche européenne de l’Indopacifique n’est relativement importante. Sur le plan géographique, Madrid estime que l’Indopacifique s’étend de la côte orientale de l’Afrique à la côte occidentale des Amériques. Une stratégie UE-Indopacifique en action se focaliserait sur les intérêts économiques de l’UE, où l’Indopacifique représenterait une opportunité pour l’Europe et l’adoption d’une stratégie UE-Indopacifique, une affirmation de l’autonomie stratégique européenne.
Indopacifique : stratégie de l’UE
Pour l’Espagne, les partenaires les plus importants dans l’Indopacifique seraient le Japon, l’Australie et la Corée du Sud, ainsi que le Vietnam et l’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN). Toutefois, le partenaire qu’elle considère comme le plus essentiel est la Chine en raison de sa position cruciale dans la région et de tout le système mondialisé. Cela incite Madrid à promouvoir la découverte d’un terrain d’entente et d’un « équilibre » avec la Chine. Le caractère démocratique du partenaire potentiel est seulement relativement important pour l’Espagne.
Sécurité européenne
Pour l’Espagne, les activités sécuritaires ne seraient pas une priorité pour une stratégie UE-Indopacifique. Elles devraient y figurer mais d’autres aspects tels que la connectivité sont plus importants. Les domaines sécuritaires dans lesquels l’Espagne aimerait que l’UE investisse le plus sont la sécurité maritime, cyber et environnementale. Pour soutenir le pilier de la sécurité maritime d’une stratégie, l’Espagne serait prête à contribuer à la liberté de navigation, à établir et à accroître sa présence militaire, à ajuster ses exportations d’armes, à renforcer l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe, à envoyer des navires de guerre dans l’Indopacifique, à financer des programmes de coopération bilatérale et des programmes européens. L’Espagne attache non seulement de l’importance à la sécurité maritime mais également au développement durable, qui selon elle est la pierre angulaire de toute stratégie européenne. Ceci est dû aux nombreux problèmes de développement durable dans l’Indopacifique, tels que la surpêche et le changement climatique. L’Espagne considère que l’aide de l’UE dans la durabilité des ressources marines est un indicateur de son engagement dans la région. Néanmoins, l’Espagne accorde beaucoup moins d’importance à la gestion durable des zones de pêche.
Développement économique
Le débat sur la connectivité numérique s’est intensifié en Espagne depuis la pandémie de Covid-19, avec la dépendance à l’égard des moyens numériques pour le télétravail et l’enseignement pendant les périodes d’isolement qui a révélé une pénurie de ressources en matière de connectivité pour les familles à revenu moyen ou faible même dans les grandes villes. La pandémie a également mis en exergue l’insuffisance des infrastructures dans les zones rurales espagnoles, non seulement les infrastructures numériques mais aussi de transport. Il n’y a pas eu de discussion sérieuse en Espagne sur la mise en place de normes multilatérales pour les investissements dans des infrastructures de qualité. Pour l’Espagne, la connectivité est surtout définie comme une menace envers les intérêts européens, et comme faisant partie d’une politique de développement, même si les discussions sur la connectivité sont largement limitées au monde universitaire ou aux groupes de réflexion. La politique espagnole en matière de connectivité est guidée par la Stratégie de connectivité de l’UE, ce qui signifie qu’il n’y a pratiquement aucun débat sur l’assistance nationale ou sur les outils de soutien aux projets de connectivité dans l’Indopacifique. En ce qui concerne les moyens de financement des projets de connectivité dans l’Indopacifique, l’Espagne répond qu’idéalement, la Stratégie de connectivité de l’UE devrait être financée via des projets publics et privés, comme par des pays européens, des donateurs multilatéraux et la Banque européenne d’investissement. L’Espagne ne donne pas la priorité aux infrastructures de transport, numériques, d’échanges entre les individus ou environnementales, car elle estime qu’elles sont toutes interconnectées au point où si l’une d’elles doit fonctionner, alors toutes les autres doivent fonctionner efficacement. Elle pense cependant que les intérêts économiques constituent les principaux critères des projets de connectivité.
Il n’y a pas de débat significatif sur la démondialisation en Espagne, même s’il y en a un sur le développement durable et l’économie circulaire. La rivalité UE-Chine inquiète l’Espagne ainsi que son impact éventuel sur le pays et notamment sur son économie. De même, il n’y a pratiquement aucune discussion autour de la diversification et de la relocalisation des chaînes d’approvisionnement, surtout depuis la résolution des pénuries de matériel médical au début de la pandémie. En ce qui concerne les accords de libre-échange (ALE), l’Espagne est favorable à des accords bilatéraux supplémentaires ALE de préférence dans un cadre plus large. Et ce parce que l’Union européenne aurait des objectifs différents en fonction des pays, tout comme les pays eux-mêmes ; les ALE bilatéraux permettent cette flexibilité. Les partenaires potentiels clé des ALE pour l’’Espagne seraient l’Indonésie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Chine. L’Espagne accorde une grande importance aux normes environnementales et sociales chez un partenaire ALE, ainsi qu’à la protection du climat et à la politique concurrentielle. À une échelle moins importante, mais non négligeable tout de même, arrive la protection de la propriété intellectuelle et la réglementation des entreprises publiques et les subventions publiques. La composante technologie de toute stratégie de l’UE devrait être centrée sur la coopération en matière de recherche et de développement, ainsi que sur l’avenir du travail et les partenariats 5G.
Estonie
Vision de l’Indopacifique
Officiellement, le ministère estonien des Affaires étrangères est responsable du développement des liens avec l’Indopacifique mais le rôle de ce ministère a été modeste dans la promotion de la discussion sur la région dans le débat public. L’Estonie maintient que les critères sur lesquels fonder les activités de la nouvelle stratégie de l’Indopacifique – considérée comme s’étendant de la côte orientale de l’Afrique à la côte occidentale des Amériques – devraient être les intérêts économiques de l’Union européenne.
Indopacifique : stratégie de l’UE
L’Estonie considère l’Indopacifique comme une région géographique qui pourrait devenir une aubaine pour l’Europe, tout en pensant que la stratégie représente un moyen de gérer l’alliance transatlantique. Pour Tallinn, le caractère démocratique des partenaires potentiels est tout à fait pertinent et se reflète dans le choix des partenaires privilégiés dans la région : les États-Unis et l’Inde.
Sécurité européenne
L’Estonie considère que le volet sécurité de la stratégie indopacifique est extrêmement important et maintient qu’il devrait y avoir davantage d’unité parmi les alliés, aussi bien au sein de l’UE qu’au-delà de l’Atlantique. En particulier, l’Estonie pense qu’il est impératif que les stratégies européenne et américaine à l’égard de l’Indopacifique soient complémentaires, afin de s’assurer que les deux n’agissent pas l’un contre l’autre dans la région. Les domaines dans lesquels Tallinn aimerait voir davantage d’investissements européens sont la sécurité maritime, cyber et environnementale. Dans ce contexte, si la future stratégie pour l’Indopacifique devait englober un volet sécurité maritime, l’Estonie serait prête à la soutenir en contribuant à la liberté de navigation, au renforcement de l’aide humanitaire et aux secours en cas de catastrophe, et en finançant des programmes de l’UE. En tant que pays côtier, elle considère que la durabilité des activités maritimes est relativement importante mais n’est pas particulièrement concernée par la question de la gestion durable des zones de pêche dans l’Indopacifique.
Développement économique
Les discussions sur la connectivité en Estonie sont pratiquement inexistantes – aussi bien au niveau du gouvernement qu’au niveau des media, et elles sont largement renvoyées à la dynamique de la concurrence grandissante entre la Chine et les Etats-Unis. À cet égard, les discussions sur la connectivité portent principalement sur l’objectif de soutenir les intérêts de Washington face à Pékin. Dans l’ordre décroissant, l’Estonie pense que la connectivité représente : une menace envers les intérêts de l’UE, une partie de la politique de développement, un instrument d’influence et une clé d’accès aux marchés. Étant donné que les discussions au sujet de la connectivité sont toujours rudimentaires, le gouvernement n’a pas encore eu l’occasion d’exprimer une préférence sur la provenance des capitaux. Ce qui est clair, c’est que les critères à suivre pour la hiérarchisation des capitaux devraient être ceux qui permettent de contrecarrer la Chine. En ce qui concerne les débats internes sur la nécessité de diversifier et de relocaliser, des discussions sont en cours sur les risques potentiels d’une instabilité économique – tels que la pandémie de Covid-19 – et les fournisseurs exclusifs. Ceci étant dit, l’Estonie serait favorable à l’établissement d’un accord de libre-échange global dans l’Indopacifique, comme moyen de renforcer la position de l’UE dans la région. À ce titre, Tallinn souhaiterait renforcer les liens avec l’Inde et l’Indonésie qui font partie de l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (TPP11), ainsi que l’Australie. Les normes sociales des futurs accords commerciaux et réglementations sur les subventions et sur les entreprises publiques ne sont pas considérées comme particulièrement pertinentes, alors que les normes environnementales et climatiques, la protection de la propriété intellectuelle et l’établissement d’une politique de la concurrence sont vues comme souhaitables.
En ce qui concerne la sphère technologique, la priorité est donnée à la coopération en recherche et développement, à une utilisation responsable de l’IA et à la cyber sécurité.
Finlande
Vision de l’Indopacifique
En Finlande, le ministère des Affaires étrangères dirige les discussions sur l’Indopacifique et l’objectif d’une approche européenne de la région est considéré comme fortement lié à la réussite de la politique étrangère et de défense du pays. Sur le plan géographique, Helsinki définit l’Indopacifique comme une région s’étendant de la côte orientale de l’Afrique aux États des Îles du Pacifique, couvrant l’océan Indien et la partie occidentale du Pacifique. Les critères sur lesquels la définition opérationnelle de l’Indopacifique devrait s’appuyer sont les intérêts économiques de l’UE et les menaces régionales qui pèsent sur ces intérêts.
Indopacifique : stratégie de l’UE
Tandis que l’Indopacifique en tant que tel est considéré comme une aubaine pour l’Europe, l’adoption d’une stratégie UE-Indopacifique serait interprétée par la Finlande comme une affirmation de l’autonomie stratégique européenne. Helsinki accorde une grande importance au caractère démocratique des pays partenaires potentiels. Cela s’exprime dans le choix de ses partenaires privilégiés dans la région : le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Inde. L’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN) serait également un précieux allié pour l’UE.
Sécurité européenne
Pour la Finlande, l’adoption d’une dimension sécuritaire dans la stratégie indopacifique serait considérée comme relativement importante, aussi bien pour collaborer avec la région en tant que telle – où elle aimerait voir un renforcement des investissements de l’UE dans la cyber sécurité et dans la gestion de crises et dans la médiation des conflits – que pour renforcer la coopération entre les États membres de l’UE. Si l’UE incluait le pilier de la sécurité maritime dans la dimension de défense de la stratégie indopacifique, Helsinki apporterait son soutien à l’aide humanitaire et aux secours en cas de catastrophe, en finançant des programmes de coopération bilatérale et des programmes européens. La promotion des activités maritimes durables ne serait que moyennement appropriée mais constituerait un complément à la propre politique étrangère du pays de promotion du développement durable, tandis que la gestion des zones de pêches ne serait pas considérée comme prioritaire.
Développement économique
La Finlande connaît des débats relativement animés au sujet de la connectivité, ce qui se traduit par une première série de mesures pout établir des projets concrets. En général, ces débats finissent habituellement à considérer les investissements chinois et le projet chinois « la Ceinture et la Route » comme une menace. On discute de la mise en place de normes multilatérales pour des investissements dans des infrastructures de qualité et il règne un soupçon sous-jacent quant à la collaboration de la Chine avec la Finlande. En général, la Finlande pense que la connectivité est une clé d’accès aux marchés et fait partie d’une politique de développement. Or elle souligne la nécessité pour l’UE de trouver un consensus unifié sur la connectivité, de façon qu’elle y soit véritablement intégrée. Ceci étant dit, les financements pour la connectivité devraient être mobilisés à partir d’une variété de sources, pour pouvoir construire une infrastructure numérique et une infrastructure de transport, et soutenir les activités liées à l’énergie, au changement climatique et aux échanges entre les peuples. La Finlande maintient que le principal moteur des projets d’infrastructure de connectivité devrait être la poursuite des intérêts économiques de l’UE.
Des discussions internes sont en cours sur la question de la démondialisation mais de l’avis général, pour un pays peu exportateur tel que la Finlande, la mondialisation a été fortement bénéfique. Suite à la pandémie de Covid-19, toutefois, le débat interne a suscité un regain d’intérêt quant à la nécessité pour la Finlande d’améliorer la sécurité de son approvisionnement national, et de développer des systèmes et des sources alternatives d’approvisionnement et de voies d’approvisionnement. Même si la Finlande est en théorie ouverte à un accord global dans la région, elle reconnaît que l’établissement d’accords de libre-échange bilatéraux serait plus envisageable. La perspective d’un accord avec la Chine ne serait pas ignorée mais Pékin aurait à se plier aux règles qui lient les autres. Les partenaires clé de la région que l’UE devrait pendre en compte sont l’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN), l’Inde, l’Indonésie et l’Australie. En ce qui concerne la sphère technologique, la Finlande donnerait priorité à des projets liés à la cyber sécurité, aux partenariats 5G et à une utilisation responsable de l’intelligence artificielle. D’autres aspects auxquels l’UE voudrait donner priorité sont le Pacte vert pour l’Europe et l’économie circulaire.
France
Vision de l’Indopacifique
En France, les discussions sur l’Indopacifique ont d’abord été engagées par le ministère des Armées qui a instauré la première stratégie indopacifique en Europe en 2018. Maintenant, les discussions sont menées par le cabinet du président et le ministère des Affaires étrangères, ainsi qu’avec le ministère des Armées et le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Seul pays européen possédant des territoires d’outre-mer dans l’Indopacifique, la France se considère comme une « puissance résidente » de la région. En tant que telle, l’Indopacifique fait déjà partie intégrante des objectifs français de défense et de politique étrangère. L’approche de l’UE envers cette région est, par conséquent, vue comme « plutôt importante » par Paris. La définition géographique française de l’Indopacifique s’étend de la côte orientale de l’Afrique à la côte occidentale des Amériques. Elle soutient que la politique régionale devrait inclure la poursuite des intérêts économiques de l’UE, la défense des intérêts de l’UE contre les menaces régionales et la coercition par des rivaux systémiques, tout en gardant un œil sur les considérations environnementales.
Indopacifique : stratégie de l’UE
Comme elle se considère comme une nation indopacifique, la France estime que la future stratégie de l’UE pour l’Indopacifique est comme un outil pour servir ses propres intérêts nationaux ainsi qu’un moyen de contrôler l’influence croissante de la Chine. Les décideurs politiques français seraient favorables à une stratégie qui vise à affirmer l’autonomie stratégique de l’UE et à renforcer l’alliance transatlantique. Dans ce contexte, un solide partenariat avec l’Australie et l’Inde constituerait un pilier essentiel pour la France. Elle considère également que le Royaume-Uni et les États-Unis sont des alliés indispensables dans la région, mais il reste encore à définir clairement comment ils pourraient travailler plus étroitement ensemble. La France apprécierait aussi une plus grande coopération avec l’Indonésie et l’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN).
Sécurité européenne
Les questions de sécurité constituent un aspect clé de la stratégie indopacifique nationale française. Ainsi, Paris espère que la nouvelle stratégie de l’UE complètera ses efforts nationaux, mais le gouvernement français est également conscient du fait que l’engagement de l’UE ne risque guère d’apporter beaucoup de valeur ajoutée dans le domaine de la sécurité. Néanmoins, il apprécierait des investissements supplémentaires de la part de l’UE dans la sécurité maritime, cyber et environnementale, ainsi que dans la lutte contre le terrorisme. Si la stratégie indopacifique de l’UE devait inclure la sécurité maritime, alors la France serait heureuse de la soutenir en contribuant à la liberté de navigation, en renforçant l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe, et en finançant des programmes de coopération bilatéraux et européens. La question de la durabilité des ressources marines – y compris des zones de pêche – est relativement importante pour la France, en particulier en ce qui concerne les zones économiques exclusives françaises dans la région. À cet égard, Paris encouragerait un engagement de la part de l’Association des États riverains de l’océan Indien.
Développement économique
Le concept de connectivité n’est pas encore bien établi en France ; sa définition politique est largement axée sur des termes individuels tels que « infrastructure » ou « transport ». En conséquence, en France, on entend par connectivité un terme vaguement défini englobant tout ce qui précède mais qui doit encore être examiné par un organe politique centralisé. Dans le contexte particulier de l’Indopacifique, les hauts fonctionnaires français interprètent largement la notion de connectivité comme une réponse au projet chinois la Ceinture et la Route. En travaillant sur la connectivité, la France pourrait poursuivre la protection des lignes de communication maritimes et soutenir tous les efforts visant à préserver un espace maritime de libre-échange. En l’absence de priorités bien établies en France – les différents ministères donnent priorité à différents agendas dans la région – énergie, climat et sécurité numérique seront probablement des priorités sur le long terme tandis que les objectifs à court terme devront faire avancer les projets d’infrastructure.
En ce qui concerne le financement des projets de connectivité, la France donnerait la priorité aux instruments européens tels que le NDICI (Neighbourhood, Development, and International Cooperation Instrument), le Fonds européen de développement et la Banque européenne d’investissement.
Ces dernières années,notamment après la pandémie de Covid-19, les discussions internes sur la nécessité de relocaliser les chaînes d’approvisionnement ont suscité un regain d’intérêt dans tous les partis politiques qui espèrent améliorer la résilience de certains secteurs de l’économie, à savoir les secteurs aéronautique, pharmaceutique et chimique. Ceci étant dit, Paris serait prêt à négocier des accords de libre-échange bilatéraux dans la région mais serait contre la conclusion d’un tel accord avec Pékin. En lieu et place, le gouvernement français serait favorable à une plus grande coopération avec des partenaires bien établis comme le Japon et l’Australie mais également l’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN) et l’Indonésie. En ce qui concerne les priorités du domaine technique, la France pense que dans le contexte de l’Indopacifique, l’UE devrait s’efforcer d’exceller dans tous les domaines, de l’avenir du travail aux partenariats 5G en passant par une utilisation responsable de l’IA. Les futures activités de recherche et développement devraient inclure l’innovation, la gouvernance des données et la cyber sécurité.
Grèce
Vision de l’Indopacifique
Le ministère grec des Affaires étrangères tient les rênes des discussions sur l’Indopacifique, qu’il définit comme une entité géographique entre la côte orientale de l’Afrique et la côte occidentale des Amériques. La perspective d’une approche européenne de l’Indopacifique est loin de figurer en bonne place de l’agenda grec de la politique étrangère et de défense. Les critères qui devraient être utilisés pour une définition opérationnelle de la stratégie devraient être : les intérêts économiques de l’Union européenne, les menaces régionales à l’encontre des intérêts stratégiques et le changement climatique ainsi que les considérations environnementales.
Indopacifique : stratégie de l’UE
La Grèce considère la région Indopacifique comme une aubaine pour l’Europe, où une stratégie unifiée devrait s’efforcer d’améliorer l’autonomie stratégique de l’UE, tenir compte des États-Unis et chercher à maintenir de bonnes relations avec la Chine. En ce qui concerne les partenariats, Athènes souhaiterait renforcer la coopération avec Washington et New Delhi mais n’exclurait pas Pékin pour autant.
Sécurité européenne
La dimension sécuritaire de la stratégie indopacifique revêt une moindre importance dans la mesure où pour la Grèce l’intérêt de s’impliquer dans des questions de sécurité militaire dans cette région si éloignée et si vaste, reste limité. La Grèce soutiendrait les politiques de l’UE dans l’Indopacifique par principe mais préfèrerait une mobilisation des efforts sur la coopération économique, la durabilité environnementale et la lutte contre le terrorisme. Si la stratégie UE-Indopacifique devait comporter un volet sur la sécurité maritime, Athènes le soutiendrait en renforçant l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe. Même si le pays reconnaît l(intérêt de soutenir la durabilité marine dans la région, il maintient que cela ne devrait pas les empêcher de poursuivre des objectifs semblables dans la Méditerranée. De même, la défense de la gestion durable des zones de pêche n’offre qu’un intérêt marginal, au moins pour l’instant car l’engagement éventuel d’Athènes dans ce domaine reste théorique.
Développement économique
En Grèce, les discussions concernant la connectivité sont réduites au minimum. Le terme « connectivité » est cité deux fois dans le plan national de croissance d’Athènes et il est principalement relégué au rôle des ports. Il n’y pas encore de discussion sur la mise en place de normes multilatérales pour des investissements dans des infrastructures de qualité. La Grèce pense que la connectivité fait partie d’une politique de développement, indispensable pour accéder aux marchés et qu’elle est un instrument de l’influence européenne. Son intérêt dans ce projet est largement motivé par des considérations économiques, dans l’espoir que les investissements liés à ce projet dynamiseront le commerce et contribueront à la relance de l’économie grecque. Quant aux outils d’assistance, de financement et de garantie à déployer pour soutenir la stratégie, la Grèce n’a pas encore fait de déclaration claire mais en théorie elle devrait apporter son soutien au modèle de stratégie en matière de connectivité entre l’UE et l’Asie. En ce qui concerne l’obtention du financement, le gouvernement préfèrerait la solution avec plusieurs financeurs et poursuivrait une stratégie inclusive de la Chine, notamment parce que la Grèce est membre de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures, même avec une faible contribution en capital. Pour Athènes, les priorités pour la région sont l’énergie et le changement climatique, ce qui reflète l’agenda grec et l’intérêt des entreprises énergétiques grecques pour la région. Le transport est également fondamental à cause du rôle important du secteur maritime grec dans le commerce mondial. Athènes serait favorable à davantage d’accords de libre-échange bilatéraux (ALE) et à l’établissement d’un ALE multilatéral, à conditions que Pékin en fasse partie. Le pays souhaiterait également collaborer avec les pays de l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (TPP11), l’Inde et l’Australie, mais est ouvert à toute discussion avec tous les acteurs de la région. En ce qui concerne la dimension technologique, un classement provisoire des priorités donnerait : coopération en recherche et développement ; l’avenir du travail et l’innovation et la commercialisation. En général, dans ses considérations relatives à l’Indopacifique, la Grèce maintient que l’UE devrait donner la priorité aux problèmes de son voisinage immédiat – à savoir la Méditerranée, où ses relations avec la Turquie dominent la politique étrangère de la Grèce.
Hongrie
Vision de l’Indopacifique
En Hongrie, le ministère des Affaires étrangères dirige les discussions sur l’Indopacifique. Le ministère ne considère pas qu’une approche européenne unifiée à l’égard de la région soit pertinente pour sa politique étrangère et de défense. Il définit l’Indopacifique comme s’étendant de l’Inde au Sud-Est asiatique et inclut la péninsule coréenne et le Japon. Pour la Hongrie, la stratégie en action devrait se concentrer sur la poursuite des intérêts économiques de l’UE.
Indopacifique : stratégie de l’UE
L’Indopacifique est considérée par Budapest comme une aubaine pour l’Europe. La Hongrie préfèrerait que la stratégie, une fois mise en œuvre, ne soit pas gouvernée par des considérations géostratégiques mais plutôt par l’objectif de soutenir la stabilité de la région et de se concentrer sur le commerce, la coopération économique et le développement. L’établissement de pays partenaires dans la région dépendrait du rôle que la stratégie indopacifique finirait par jouer. Au bout du compte, la Hongrie se méfie d’une stratégie sapant les intérêts de la Chine d’une manière ou d’une autre.
Sécurité européenne
La Hongrie préfèrerait que la stratégie UE-Indopacifique ne comporte aucun volet sécuritaire du tout. Le pays n’a aucun intérêt, et en fait s’y oppose, à ce que la moindre action ait un impact négatif sur ses relations avec la Chine. Elle maintient donc que les questions de sécurité qui pourraient être conflictuelles, en particulier celles qui pourraient exaspérer la Chine, ne devraient pas figurer dans la stratégie. Comme Budapest maintient que la stratégie devrait être principalement orientée vers la poursuite des intérêts économiques, un volet sécurité serait acceptable aussi longtemps qu’il soutiendrait les intérêts économiques tels que la lutte contre la piraterie dans l’océan Indien. En conséquence, dans la rédaction d’un volet sécurité maritime, la Hongrie aimerait voir davantage d’investissements dans la sécurisation des routes maritimes et dans la promotion du rôle de l’UE comme médiateur dans la résolution des conflits.
Développement économique
Des discussions sur la connectivité dans l’Indopacifique ont bien lieu en Hongrie et elles portent sur le rôle de la future stratégie comme facilitateur de l’accès aux marchés et outil de la coopération et du développement économiques. À cet égard, la Hongrie aimerait que l’UE donne priorité aux infrastructures de transport, à savoir la route et le rail, ainsi qu’à la connectivité énergétique et au développement de l’interconnectivité énergétique de la Hongrie via des connexions avec les pays voisins, des flux inverses, de nouveaux pipelines et de nouvelles sources. Il n’y a encore aucune discussion – du moins pas officiellement – au sujet de l’assistance, du financement et des outils de garantie que les Européens pourraient déployer pour soutenir les projets de connectivité. Cependant, la Hongrie serait favorable à l’obtention de capitaux issus de plusieurs sources. Le besoin d’investir dans la région est tellement vaste qu’il serait important de solliciter de multiples donateurs et d’avoir un financement multilatéral avec la participation de banques de développement, de pays de la région et de sources privées éventuelles. Ceci étant dit, la Hongrie ne pense pas que la Chine devrait être exclue des contributions financières aux projets ; Budapest estime que cela pourrait aider les acteurs régionaux à s’adapter aux normes internationales. La question de la démondialisation n’est pas discutée au niveau du gouvernement ni au niveau de la population au sens large mais elle gagne du terrain dans le monde universitaire. En conséquence, la Hongrie soutiendrait volontiers l’établissement d’accords commerciaux bilatéraux ainsi qu’un accord global régional, en particulier avec les pays de l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (TPP11), le Japon, la Corée du Sud et l’Indonésie. En ce qui concerne les priorités dans le domaine de la technologie, la Hongrie pense que l’innovation et la commercialisation, la cyber sécurité et l’avenir du travail sont les axes de travail les plus pertinents.
Irlande
Vision de l’Indopacifique
En Irlande, les discussions sur l’Indopacifique sont menées par le ministère des Affaires étrangères qui pense que l’objectif d’une approche de l’UE de la région est très important pour atteindre ses propres objectifs de politique étrangère et de défense. Sur le plan géographique, l’Irlande définirait l’Indopacifique comme s’étendant du Pakistan aux Îles du Pacifique. En termes de priorités pour l’Indopacifique, l’Irlande privilégierait la poursuite des intérêts économiques de l’UE, le changement climatique et les considérations environnementales.
Indopacifique : stratégie de l’UE
Dublin estime que la région Indopacifique est une aubaine pour l’Europe, où l’adoption d’une stratégie unifiée représenterait l’affirmation de l’autonomie stratégique européenne. L’Irlande poursuivrait des partenariats avec les États-Unis, la Chine et l’Inde principalement, qu’elle considère comme des acteurs tout aussi importants en termes de pertinence à l’échelon de la région et en compensant les intérêts divergents. L’Irlande a récemment renforcé son engagement avec la Nouvelle-Zélande et considère le pays comme un autre acteur attaché aux mêmes valeurs qui pourrait permettre d’établir un partenariat travaillant dans l’Indopacifique, en particulier compte tenu du fait que Dublin considère que le caractère démocratique des partenariats potentiels est important.
Sécurité européenne
L’Irlande n’est pas motivée par des considérations sur la sécurité lorsqu’elle évalue sa collaboration avec la région, et préfère plutôt se concentrer sur le commerce et le développement. Ceci étant dit, selon les méthodes utilisées, Dublin s’intéresserait à des opérations de maintien de la paix, en renforçant l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe. L’Irlande serait favorable à ce que l’Union européenne injecte davantage de fonds dans la cyber sécurité, la sécurité environnementale, la gestion des crises et la médiation des conflits. Ni la durabilité des ressources marines ni la gestion durable des zones de pêche ne figurent dans les premières priorités.
Développement économique
En tant que nation insulaire, les questions de connectivité ont depuis longtemps fait l’objet de débats dans la politique étrangère irlandaise. Dublin s’intéresse surtout à : la connectivité numérique et à l’économie de service, y compris les services financiers ; l’augmentation du nombre de lignes aériennes directes avec l’Indopacifique ; et au renforcement des échanges agricoles avec l’Asie. L’Irlande ordinairement considère que la combinaison de ses réseaux informatiques et de communication, dotés d’une connectivité aérienne et maritime à haut volume, en font un hub potentiel pour les marchés mondiaux plus largement. La stratégie interne de l’Irlande pour l’Indopacifique est complémentaire avec le travail fait centralement à Bruxelles et est destinée à permettre de coopérer avec des forums multilatéraux. En général, l’Irlande serait favorable à un engagement multilatéral par l’intermédiaire de l’UE, la Banque asiatique de développement et la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures. Par ailleurs, sa perception de la stratégie UE-Indopacifique repose sur un engagement visant à nouer de nouveaux partenariats à l’avenir pour soutenir la mise en œuvre du programme et pour concrétiser des opportunités commerciales pour l’Irlande. Au total, l’Irlande pense que les intérêts économiques devraient guider la collaboration de l’UE avec la région. En tant que hub mondial pour des investissements multinationaux, l’Irlande a tout intérêt à maintenir – et à renforcer – les liens mondiaux, y compris avec l’Indopacifique. Les discussions sur la diversification et la relocalisation sont nées à cause du Brexit, compte tenu du niveau d’interdépendance entre l’Irlande et le Royaume-Uni. Quant à la mise en place des accords commerciaux, l’Irlande prône une collaboration flexible avec la région, collaboration qui pourrait inclure des accords bilatéraux, le cas échéant, et des accords avec des blocs de pays, lorsque cela est préférable et faisable. Un seul accord de libre-échange pour la région indopacifique ne constitue pas l’approche la plus pragmatique, compte tenu de la diversité des acteurs et de la grande variété d’intérêts en jeu. L’Irlande est d’accord pour dire que la Chine est à la fois un rival et un partenaire, et elle pense qu’il n’est pas prudent d’exclure Pékin de futurs traités commerciaux éventuels, bien qu’un accord bilatéral semble être l’approche la plus raisonnable, compte tenu de la taille de la Chine, de sa singularité et de son importance économique. L’UE devrait encourager des partenariats avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon. Dans le domaine de la technologie, l’UE devrait donner la priorité à la recherche et au développement, à la gouvernance des données et à un usage responsable de l’IA.
Italie
Vision de l’Indopacifique
En Italie, les discussions sur l’Indopacifique sont menées par le ministère des Affaires étrangères qui considère qu’une approche unifiée de l’UE à l’égard de la région est tout à fait appropriée à sa politique étrangère et de défense. D’un point de vue géographique, l’Italie considère que l’Indopacifique s’étend de la côte orientale de l’Afrique aux Îles du Pacifique. Sur le fond, Rome considère que l’Indopacifique est une région importante pour les intérêts économiques de l’Union européenne, pour les menaces régionale qui pèsent sur les intérêts stratégiques de l’UE, pour le changement climatique et les considérations environnementales.
Indopacifique : stratégie de l’UE
De l’avis de l’Italie, l’Indopacifique, sur le plan géographique, est une aubaine pour l’Europe. L’adoption d’une stratégie unifiée à l’égard de la région signifierait pour l’Italie une affirmation de l’autonomie stratégique européenne. Dans l’établissement de partenariats avec des acteurs régionaux, l’Italie donnerait priorité à une collaboration avec le « Quad » qui regroupe l’Inde, l’Australie, le Japon et les États-Unis. La posture italienne sur la Chine reste nuancée et l’Italie aura peut-être quelques difficultés à s’adapter si la nouvelle stratégie UE-Indopacifique adopte une position différente. Si l’essentiel de la stratégie est la poursuite des intérêts économiques de l’UE, alors – selon les responsables italiens – la Chine, en tant que partenaire commercial et économique important, devrait être invitée à la discussion. L’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN) et l’Association des États riverains de l’océan Indien (IORA) devraient également être conviées.
Sécurité européenne
Pour le moment, la stratégie indopacifique devrait se concentrer sur l’établissement d’une relation constructive avec des partenaires de la région en se focalisant sur les activités commerciales. À l’avenir, le volet sécuritaire pourrait devenir plus pertinent mais pour le moment, Rome considère la question comme secondaire. À part la sécurité maritime, cyber et environnementale, cette dimension devrait inclure la lutte contre le terrorisme et la gestion de crises et tenir aussi compte des moyens de lutte contre la piraterie. Si la stratégie visait à englober la sécurité maritime, l’Italie la soutiendrait en contribuant à la liberté de navigation, en renforçant l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe, en finançant des programmes de coopération bilatérale et en finançant des programmes européens. L’Italie accorde une haute priorité à des thèmes tels que le développement durable des activités marines et la gestion durable des zones de pêche.
Développement économique
Plusieurs conversations sur la connectivité ont lieu en Italie, en mettant fortement l’accent sur les infrastructures portuaires et les câbles sous-marins en particulier. D’autres aspects des discussions portent sur l’amélioration de la connectivité énergétique dans le bassin méditerranéen et sur la nécessité d’établir des réseaux 5G gratuits et ouverts. Ces discussions traitent de la nécessité de mettre en place des normes multilatérales pour des investissements dans des infrastructures de qualité, ce qui est lié aux Principes du G20 pour l’investissement dans des infrastructures de qualité, en incluant des considérations environnementales ciblant des objectifs de développement durable, un plus grand usage de la gestion du risque dans la conception des infrastructures, l’ouverture et la transparence et des institutions de gouvernance efficaces. L’Italie considère que la connectivité représente une importante clé d’accès aux marchés et qu’elle fait partie d’une politique de développement, en mettant l’accent en particulier sur le développement économique et la sécurité énergétique. D’autres aspects de la conversation sur la connectivité s’attachent à l’avancement des intérêts internes en Méditerranée grâce aux infrastructures liées à la connectivité. En ce qui concerne la préférence de l’Italie à l’égard du choix des outils d’assistance, de financement et de garantie, l’Italie souligne l’importance de son statut en tant que partenaire de développement officiel de l’ASEAN et insiste sur le lien qui existe entre l’Italie et IORA vis-à-vis de l’économie bleue. Concernant la mobilisation des capitaux à investir dans les projets de connectivité, Rome serait favorable à des investissements européens et multilatéraux, l’intérêt économique étant l’élément moteur de la priorisation des projets. Les Italiens préfèreraient se concentrer sur l’énergie et le changement climatique, le transport et les infrastructures numériques. Étant donné que l’économie italienne dépend fortement des exportations, la conversation sur la démondialisation porte sur la diversification – en particulier liée aux chaînes d’approvisionnement sanitaire et aux rachats d’entreprises nationales par des étrangers. Ceci étant dit, l’Italie serait d’accord pour établir de nouveaux accords bilatéraux de libre-échange dans l’Indopacifique. Compte tenu de la complexité de la question de la Chine, toute proposition visant à inclure la Chine devrait être soigneusement examinée au niveau européen. Tous les pays de la région seraient des partenaires viables mais l’Italie donnerait la priorité à l’ASEAN pour négocier des accords de libre-échange. La composante technologique de la stratégie UE-Indopacifique devrait porter principalement dans l’ordre d’importance sur l’innovation et la commercialisation, la gouvernance des données, l’avenir du travail et la cyber sécurité.
Lettonie
Vision de l’Indopacifique
En Lettonie, la conversation sur l’Indopacifique est menée par le ministère des Affaires étrangères, pour qui une approche européenne de la région est très importante pour les objectifs de défense et de politique étrangère du pays. La définition géographique de l’Indopacifique s’étendrait du Pakistan aux Îles du Pacifique. Pour la Lettonie, opérationnaliser la stratégie signifierait s’appuyer sur les critères des intérêts économiques de l’UE et les importantes menaces qui pèsent sur la région, ainsi que les questions de sécurité et de défense.
Indopacifique : stratégie de l’UE
Riga estime que le concept de l’Indopacifique est un outil stratégique pour lutter contre la Chine et pense que l’adoption d’une stratégie unifiée à long terme vis-à-vis de la région est un alignement avec les objectifs des Etats-Unis. Ceci étant dit, Riga pense que le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Inde seraient les partenaires les plus appropriés pour l’UE dans la région.
Sécurité européenne
Pour la Lettonie, la dimension sécuritaire de la stratégie indopacifique de Bruxelles est centrale, car elle voit la stratégie largement par le prisme des intérêts américains. La Lettonie maintient qu’une stratégie européenne ne devrait pas exister sans un alignement avec Washington, notamment vis-à-vis des menaces sur la sécurité que représente la Chine dans l’Indopacifique. Cette dimension sécuritaire ne devrait pas remettre en question les structures de sécurité existantes de l’OTAN, et devrait être déployée en montrant l’exemple et en fixant des règles et des normes. Si un pilier sécurité maritime devait être inclus dans la stratégie, la Lettonie le soutiendrait en renforçant l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe, ainsi qu’en finançant des programmes bilatéraux. Elle considèrerait la durabilité des ressources marines, largement comprises dans le cadre de la liberté de navigation, comme hautement importante. La question de la gestion durable des zones de pêche est aussi une priorité pour la Lettonie qui juge qu’il serait souhaitable que la politique commune de l’UE en matière de zones de pêche soit imitée par les acteurs internationaux.
Développement économique
Des discussions sur la connectivité ont lieu en Lettonie et ont évolué en partant d’une attitude largement favorable à une collaboration avec les pays d’Asie, y compris la Chine, vers 2016-2017 à un changement d’attitude depuis 2018 nettement plus axée sur la sécurisation. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, les discussions sont même allées plus loin pour inclure la sécurité des chaînes d’approvisionnement. La Lettonie considère largement la connectivité comme un outil destiné à faire face aux menaces qui pèsent sur les intérêts européens dans la région, ainsi qu’à concrétiser l’influence et la coercition de l’UE, en particulier dans le contexte de l’accès aux marchés. Le pays a également discuté de la façon de transformer la Lettonie en un hub de transit. Au niveau national, les discussions sont inexistantes sur la fourniture d’outils d’assistance, de financement et de garantie pour soutenir l’activité dans l’Indopacifique. Pendant ce temps, le pays préfèrerait voir la mobilisation de capitaux venir d’un financement bilatéral de la Banque européenne d’investissement et de donateurs multilatéraux, car il serait compliqué pour la Lettonie de regrouper des financements pour des projets dans une région considérée par beaucoup dans le pays comme lointaine. Dernièrement, pourtant, les principaux critères de priorisation des infrastructures de connectivité étaient de savoir si cela aiderait à contrer la Chine ou non. Des discussions sur la diversification et la relocalisation de ressources en Lettonie portent principalement sur la nécessité de retirer la production de la Chine vers des pays plus sûrs et moins chers. À cet égard, Riga préfèrerait l’établissement d’un accord de libre-échange global (ALE) avec des partenaires de l’Indopacifique au lieu d’avoir des accords bilatéraux individuellement avec des pays, Toutefois, dans un ALE global l’inclusion de la Chine ne serait pas obligatoire. Les petits États des Îles du Pacifique, l’Australie, l’Indonésie, les Etats-Unis et le Canada seraient les partenaires clé de l’Europe dans cet effort. En ce qui concerne la sphère technologique, la Lettonie donnerait priorité aux investissements dans les partenariats 5G, l’innovation et la commercialisation ainsi que la gouvernance des données.
Lituanie
Vision de l’Indopacifique
En Lituanie, le débat sur l’Indopacifique est dirigé par le ministère des Affaires étrangères qui estime que l’objectif d’une stratégie de l’UE dans la région est relativement important pour ses objectifs en matière de défense et de politique étrangère. Sur le plan géographique, la Lituanie définit la région comme commençant au niveau de la côte orientale de l’Afrique jusqu’à la côte occidentale des Amériques. Les intérêts économiques européens, la coercition par des rivaux systémiques et des organisations multilatérales régionales comme l’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN) sont des facteurs importants que l’UE devrait prendre en compte au moment de décider comment faire de la stratégie une réalité.
Indopacifique : stratégie de l’UE
La Lituanie considère l’Indopacifique aussi bien comme une aubaine pour la Chine qu’un outil stratégique contre la Chine. Vilnius pense que la future stratégie est un alignement avec les États-Unis et une manière de gérer les relations transatlantiques. Elle estime que l’Inde, les États-Unis et la Corée du Sud sont les partenaires clé de la région, reflétant l’importance que la Lituanie accorde au caractère démocratique des partenaires potentiels. Elle considère également l’ASEAN comme un acteur important avec lequel collaborer.
Sécurité européenne
La Lituanie n’a pas d’intérêts sécuritaires directs dans la région. Cela, associé à son budget de défense limité, signifie qu’elle ne donne pas la priorité à la dimension sécuritaire de la future stratégie. Ceci étant dit, si l’Union européenne lançait des missions axées sur la sécurité dans l’Indopacifique, Vilnius participerait probablement sur la base d’un engagement général à l’égard de l’UE. La perception lituanienne de la pertinence de la dimension sécuritaire de la stratégie serait directement proportionnelle à l’implication ou à la non-implication des Etats-Unis. Dans ce contexte, le gouvernement considèrerait l’établissement d’un partenariat dans le domaine de la cyber sécurité avec les pays « Quad » comme très important. Le développement durable, y compris la durabilité des ressources marines et de la gestion des zones de pêche, seraient les points les plus urgents à traiter, conformément aux principes fondamentaux de la politique étrangère et de développement de l’UE.
Développement économique
La Lituanie suit la définition de la connectivité telle qu’on la trouve dans la stratégie européenne sur « Relier l’Europe et l’Asie » – en d’autres termes, en tant que concept couvrant le transport, l’énergie, le numérique et la connectivité entre les peuples. Le pays donne la priorité aux infrastructures de transport suivies des échanges entre les peuples, à savoir le tourisme et les échanges entre étudiants. Il pense que la connectivité numérique et énergétique fait partie intégrante de toute croissance économique mais qu’elle ne gagnera en pertinence que dans l’avenir. L’approche de la Lituanie à l’égard de la région est centrée sur les objectifs de la diversification économique et l’accès à de nouveaux marchés. Cela est, en partie, conditionné par la concurrence géopolitique plus large avec Pékin, mais les intérêts économiques prédominent.
C’est peut-être parce que le gouvernement n’a pas encore un seul service qui travaille sur la connectivité, qu’il n’y a pas encore de véritable conversation en Lituanie sur l’assistance, le financement et les outils de garantie à utiliser pour soutenir la future stratégie. De même, il n’y a pas de discussion de fond sur les mécanismes de financement les plus appropriés qui pourraient prioriser une approche mixte. La question de la démondialisation n’est pas particulièrement discutée dans le pays, alors que celles liées à la diversification et à la relocalisation des chaînes d’approvisionnement ont été exacerbées par la pandémie de Covid-19 : la concentration de la production des biens essentiels à l’étranger – notamment en Chine – est vue comme problématique et potentiellement dangereuse. D’autre part, les entreprises technologiques en particulier voient la perspective de la relocalisation comme une occasion éventuelle d’attirer davantage d’investissements issus des marchés européens occidentaux. La Lituanie verrait la conclusion d’un accord de libre-échange bilatéral (ALE) UE-ASEAN comme un dénouement idéal mais reconnaît que l’établissement d’un ALE individuel serait probablement plus faisable. Dans ce sens, l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et Singapour seraient considérés comme des partenaires attachés aux mêmes valeurs. En technologie, Riga donnerait la priorité à la gouvernance des données, aux partenariats 5G et à un usage responsable de l’IA sans oublier d’insister sur la nécessité d’étudier des restrictions sur les flux de données dans l’Indopacifique.
Luxembourg
Vision de l’Indopacifique
Au Luxembourg, les discussions sur l’Indopacifique sont menées par le ministère des Affaires étrangères qui considère que le potentiel d’une stratégie unifiée est relativement important pour sa politique étrangère et ses objectifs de défense. Sa définition de la région s’étend de la côte orientale de l’Afrique aux Îles du Pacifique, y compris l’Océanie. Les moteurs de la stratégie en action seraient les intérêts économiques de l’UE, les menaces régionales qui pèsent sur les intérêts stratégiques de l’UE, le changement climatique et les considérations environnementales.
Indopacifique : stratégie de l’UE
Le Luxembourg estime que l’Indopacifique est une aubaine pour l’Europe et que la stratégie permettra de favoriser une approche cohérente de l’océan Indien, articulée autour du concept de coopération avec des partenaires clé en Afrique et en Asie. En ce qui concerne l’établissement de partenariats dans la région, il pense que l’Union européenne devrait choisir avec qui coopérer sur la base de points politique spécifiques où les partenaires peuvent trouver un terrain d’entente et sur la base de principes et de valeurs communs ou d’intérêts mutuels. Dans ce sens, même si le Luxembourg considère que le caractère démocratique des partenaires possibles est important, il établirait des partenariats avec la Chine ainsi qu’avec l’Australie et le Japon.
Sécurité européenne
En tant que petit État aux capacités de défense limitées, l’intérêt du Luxembourg pour la dimension sécuritaire est minime, en particulier si l’on considère la distance géographique qui le sépare de la région Indopacifique. Il favoriserait plutôt l’établissement de relations bilatérales avec des pays individuellement. Ceci étant dit, le Luxembourg serait favorable à des investissements de l’UE dans la sécurité maritime, cyber et environnementale, ainsi que dans la lutte contre le terrorisme, la gestion de crises et la médiation des conflits. Le Luxembourg n’a pas – encore – de stratégie claire sur la façon dont il soutiendrait un éventuel pilier de sécurité maritime mais il considèrerait la durabilité des activités marines et la gestion durable des zones de pêche comme une priorité.
Développement économique
Dans le pays, les discussions sur la connectivité existent et sont essentiellement axées sur les services. La connectivité est largement vue sous un angle économique : les réponses à l’enquête « partie d’une politique de développement » et « clé d’accès aux marchés » arrivent en tête tandis que la dimension géopolitique ne reçoit que peu d’écho. Le Luxembourg suggèrerait à la Banque européenne d’investissement (BEI) de financer un outil d’assistance, de financement et de garantie. Il proposerait un financement provenant de donateurs multilatéraux, un financement bilatéral et la BEI. Les priorités indiquées par le Luxembourg concernant la connectivité seraient les infrastructures numériques suivies de l’énergie et du changement climatique et des infrastructures de transport. La durabilité de ces projets devrait être le principal critère de sélection des projets. Quant à la démondialisation, au Luxembourg la crise de la Covid-19 s’est traduite par un renforcement du débat sur l’autonomie stratégique européenne. Le Luxembourg soutient que, suite aux récents accords passés avec le Japon, la Corée du Sud, Singapour et le Vietnam, l’UE devrait essayer de conclure des accords bilatéraux similaires avec l’Australie, l’Indonésie et la Nouvelle-Zélande, et devrait prendre des mesures supplémentaires pour conclure l’Accord global sur les investissements avec la Chine. L’UE devrait aussi explorer et approfondir ses relations économiques avec l’Inde et poursuivre en général ses relations commerciales avec tous les partenaires qui partagent les mêmes valeurs, principes et intérêts mutuels. En ce qui concerne le volet technologique de la stratégie de l’Indopacifique, la gouvernance des données, la cyber sécurité et un usage responsable de l’IA seraient les priorités.
Malte
Vision de l’Indopacifique
À Malte, le débat sur la stratégie de l’Indopacifique est mené par le ministère des Affaires étrangères qui ne considère pas l’objectif d’établir une approche européenne de la région comme une priorité pour sa propre politique étrangère et ses objectifs de défense. Malte maintient que la définition géographique de la région devrait s’étendre de la côte orientale de l’Afrique à la côte occidentale des Amériques. La stratégie finale devrait englober les intérêts économiques et de l’UE, le changement climatique et des considérations environnementales.
Indopacifique : stratégie de l’UE
Pour cette île, l’Indopacifique représente une aubaine pour l’Europe, où une stratégie européenne se traduirait par une affirmation de l’autonomie stratégique européenne. Les partenaires clé de la région avec lesquels l’Union européenne devrait s’efforcer de renforcer des liens sont le Japon, l’Australie et la Chine. L’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN) serait également invitée dans la conversation. Le caractère démocratique ou autre, des partenaires potentiels n’est pas nécessairement considéré comme une priorité.
Sécurité européenne
Malte ne verrait pas la potentielle dimension sécuritaire de la stratégie de l’Indopacifique comme une priorité mais encouragerait l’UE à réorienter les capitaux vers la sécurité maritime et environnementale. Si la stratégie de l’UE pour la région incluait le pilier de la sécurité maritime, Malte la soutiendrait en finançant une coopération bilatérale et des programmes européens. Elle estime que la durabilité des ressources marines est relativement importante, tandis que la gestion durable des zones de pêche n’aurait qu’un rôle secondaire.
Développement économique
Actuellement, la politique maltaise ne s’occupe pas de la connectivité ni de développement d’infrastructures liées à l’Indopacifique, ni de la mise en place de normes multilatérales. De manière générale, Malte donnerait sa priorité à une stratégie sur la région motivée par des intérêts économiques et, ainsi verrait que la connectivité est une clé d’accès aux marchés et qu’elle fait partie d’une politique de développement. Malte s’intéresserait principalement aux infrastructures numériques, aux échanges entre les peuples et aux infrastructures de transport tout en pensant que les capitaux devraient provenir de financements bilatéraux de la Banque européenne d’investissement. Malgré le fort impact de la pandémie à Malte, notamment compte tenu de ses ressources nationales limitées et de sa forte dépendance à l’égard des chaînes d’approvisionnement extérieures, il n’existe aucun débat perceptible en cours sur la démondialisation ou la relocalisation des chaînes d’approvisionnement. En ce qui concerne les négociations d’autres accords de libre-échange, Malte reste ouverte à différentes options, tant que Pékin est présenté comme une partie prenante digne d’intérêt. L’ASEAN, les pays qui font partie de l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique et l’Inde seraient d’autres partenaires potentiels qui pourraient permettre de concrétiser les efforts de l’UE dans la région. Quant à la sphère technologique, Malte définirait la coopération en matière de recherche et de développement, l’innovation et la commercialisation, et l’avenir du travail comme les composantes clé de la stratégie.
Pays-Bas
Vision de l’Indopacifique
Les conversations hollandaises sur l’Indopacifique sont menées par le ministère des Affaires étrangères, pour qui la stratégie UE-Indopacifique devrait jouer un rôle crucial dans ses objectifs de politique étrangère et de défense. Les Pays-Bas définissent l’Indopacifique comme une région s’étendant du Pakistan aux Île du Pacifique et ils aimeraient voir la stratégie opérationnalisée en poursuivant les intérêts économiques de l’UE, en faisant face aux menaces régionales qui pèsent sur les intérêts stratégiques de l’UE, en s’attaquant à la coercition économique des rivaux systémiques sans oublier le changement climatique et les considérations environnementales. Outre ces critères, la nouvelle stratégie devrait englober la sécurité internationale, cyber et maritime, ainsi que les chaînes de valeur mondiales, la santé, la pauvreté, la migration, les droits de l’homme et l’État de droit international.
Indopacifique : stratégie de l’UE
Pour les Pays-Bas, le moteur politique derrière le concept de l’Indopacifique consiste à reconnaître l’importance économique et géopolitique de la région et à renforcer l’aptitude de l’Union européenne à agir. Dans ce contexte, l’adoption d’une stratégie Indopacifique représenterait l’affirmation de l’autonomie stratégique de l’UE, tout en soulignant dans le même temps l’importance de l’alliance transatlantique. Dans ce sens, les Pays-Bas estiment que l’Australie et les États-Unis devraient être considérés comme les principaux partenaires de l’UE dans la région, ainsi que le Canada et les pays membres de l’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN). En fonction de la nature ultime de l’initiative, d’autres partenaires, comme le Sri Lanka, pourraient être inclus.
Sécurité européenne
Le gouvernement hollandais considère que la sécurité et une priorité à inclure dans la stratégie Indopacifique de l’UE, en particulier parce que l’importance géopolitique de la région continue de croître. Il pense que l’UE devrait investir davantage dans la sécurité maritime et cyber, ainsi que dans la lutte contre le terrorisme. Concrètement, les Pays-Bas apporteraient leur soutien au pilier potentiel de la sécurité maritime de la stratégie en contribuant à la liberté de navigation, en rééquilibrant les exportations d’armes et en renforçant l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe. Par ailleurs, ils enverraient des navires de guerre dans la région et financeraient des programmes de coopération bilatérale ainsi que des programmes européens. Les Pays-Bas considèreraient la durabilité des ressources marines et la gestion des pêcheries comme relativement appropriées : ils seraient d’accord pour envisager de s’impliquer dans ces domaines mais ce ne sont pas les aspects les plus importants de la stratégie actuelle hollandaise à l’égard de l’Indopacifique.
Développement économique
Les discussions sur la connectivité aux Pays-Bas ont lieu et complètent la stratégie hollandaise. Ce document stipule que dans le cadre de la stratégie de l’UE sur la connectivité, les Pays-Bas se focaliseront sur le numérique, en examinant une série de thèmes dont la cyber sécurité et la réglementation d’internet, l’innovation, l’intelligence artificielle, le commerce en ligne, le transfert transfrontalier de données, la vie privée et la souveraineté numérique nationale.
Les Pays-Bas se préparent également à rejoindre les initiatives européennes visant à renforcer l’autonomie stratégique de l’Europe, notamment en participant aux discussions actuelles sur le meilleur moyen de parvenir à un équilibre entre la diversification des chaînes d’approvisionnement et de valeur d’une part et le renforcement de systèmes de libre-échange mondial et multilatéral d’autre part. Le pays se prépare aussi à se joindre à la mise en place du Pacte vert pour l’Europe au niveau international, en coopérant avec des partenaires de l’Indopacifique attachés aux mêmes principes. L’agenda hollandais de la connectivité est largement considéré comme un jeu d’équilibre avec le projet chinois la Ceinture et la Route mais les Pays-Bas n’iraient pas jusqu’à le définir comme un outil de coercition parce qu’ils proposeraient une alternative au lieu de poursuivre une stratégie antagoniste directe. Même si ce pays dépend lourdement du commerce international, aux Pays-Bas on discute un peu de la nécessité de la démondialisation. Ceci étant dit, la crise de la Covid-19 a suscité des débats sur le besoin d’une plus grande autonomie stratégique de l’UE. Sur la question d’établir de nouveaux accords de libre-échange dans la région, le gouvernement aimerait que les négociations avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande aboutissent rapidement. À cet égard, il serait ouvert à d’autres accords avec l’Inde et l’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN). La question de savoir s’il faut établir un tel accord avec la Chine reste délicate, la réponse dépendant de l’état de préparation de Pékin à adopter les normes de l’UE. Dans le domaine de la technologie, les Pays-Bas poursuivraient l’innovation et la commercialisation en premier, puis la gouvernance des données, la coopération en matière de recherche et développement, et un usage responsable de l’IA.
Pologne
Vision de l’Indopacifique
En Pologne, le débat sur l’Indopacifique est dirigé par le ministère des Affaires étrangères et par rapport aux objectifs de sa défense et de sa politique étrangère dans la région, il est seulement considéré comme assez important. En termes géographiques, l’idée que la Pologne se fait de l’Indopacifique va du Pakistan aux Îles du Pacifique, et la définition opérationnelle que l’UE devrait adopter d’après Varsovie, devrait inclure la défense des intérêts économiques de l’UE, réagir contre les menaces régionales à l’encontre des intérêts stratégiques de l’UE et répondre à la coercition économique exercée par les rivaux systémiques.
Indopacifique : stratégie de l’UE
Pour la Pologne, l’Indopacifique est à la fois une aubaine pour l’Europe et un outil stratégique contre la Chine. L’adoption de la stratégie UE-Indopacifique dans ce sens serait considérée comme un alignement avec les États-Unis. Les pays que la Pologne envisagerait comme partenaires clé dans la région seraient l’Inde, les Etats-Unis et le Japon, ainsi que l’Indonésie, le Vietnam et les Philippines. À cet égard, le caractère démocratique d’un potentiel pays partenaire n’est pas jugé comme un critère important.
Indopacifique : stratégie de l’UE
L’inclusion d’une dimension sécuritaire dans la stratégie Indopacifique serait jugée relativement importante par la Pologne, qui aimerait voir davantage d’investissements européens dans la sécurité maritime et cyber, ainsi que dans la lutte contre le terrorisme. Si un pilier sur la sécurité maritime était intégré dans cette stratégie, la Pologne le soutiendrait en contribuant à la liberté de navigation, au renforcement de l’aide humanitaire, aux secours en cas de catastrophe et au financement des programmes de coopération tant bilatéraux qu’européens. Elle considèrerait la durabilité des ressources marines et la gestion durable des zones de pêche comme secondaires mais elle pourrait y participer en établissant des actions de contrôle des pêcheries dans la région.
Développement économique
Les discussions sur la connectivité en Pologne portent principalement sur l’Europe et l’Eurasie occidentale et seulement indirectement sur l’Indopacifique, via le projet chinois la Ceinture et la Route, et la participation de la Pologne au cadre du format « 16+1 » de la Chine. La Pologne ne discute pas encore de la mise en place de normes multilatérales pour des infrastructures de qualité. Varsovie estime que la connectivité est un outil d’influence et de coercition, une clé d’accès aux marchés et un outil pour protéger les intérêts de l’UE dans la région.
Aucune discussion sérieuse sur l’assistance, le financement et les outils de garantie à utiliser dans la région n’a encore été soulevée, ne fut-ce que parce que la Pologne est peu impliquée dans l’Indopacifique à titre individuel. En poursuivant une stratégie de connectivité, elle pense que l’objectif devrait être de poursuivre des intérêts économiques. À cet égard, la priorité devrait être donnée à l’énergie et au changement climatique, au numérique et aux infrastructures de transport. Les discussions sur la démondialisation en Pologne se limitent à examiner les questions relatives aux chaînes d’approvisionnement, en particulier à l’impact que les crises et les conflits à l’étranger pourraient avoir sur l’Europe. Idéalement, la Pologne serait favorable à un accord de libre-échange global avec la région mais est consciente des difficultés pour y parvenir. L’Australie, les Etats-Unis et les pays de l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (TPP11) seraient tout à fait appropriés à cet égard. Quant à la technologie, Varsovie donnerait la priorité à l’établissement de projets concernés par l’innovation et la commercialisation, la gouvernance des données et la cyber sécurité.
Portugal
Vision de l’Indopacifique
Le débat de Lisbonne sur l’Indopacifique est mené par le ministère des Affaires étrangères qui considère que la mise en place d’une stratégie européenne est une priorité pour atteindre ses objectifs nationaux en défense et en politique étrangère. Le Portugal définit la région comme s’étendant de la côte orientale de l’Afrique aux Îles du Pacifique, y compris les anciennes colonies portugaises, le Mozambique et le Timor oriental. Les critères permettant de décider comment concrétiser la stratégie sont entre autres les intérêts économiques de l’UE, les menaces régionales à l’égard des intérêts stratégiques européens, le changement climatique et les considérations environnementales.
Indopacifique : stratégie de l’UE
Pour le Portugal, l’Indopacifique est une aubaine pour l’Europe et également un outil stratégique de lutte contre la Chine. Lisbonne estime qu’adopter une stratégie unifiée face à la région représenterait une affirmation de l’autonomie stratégique européenne, un alignement avec les États-Unis et un outil pour gérer l’alliance transatlantique. Dans la région, le Portugal donnerait la priorité à l’établissement de partenariats avec le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l’Inde et le Japon. Par ailleurs, l’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN) et les pays appartenant à la Communauté des pays lusophones – Mozambique et Timor oriental notamment – devraient également être considérés comme de potentiels partenaires.
Sécurité européenne
Concernant la mise en place d’une dimension sécuritaire dans la nouvelle stratégie Indopacifique, le Portugal a des sentiments mitigés : les activités sécuritaires effectuées dans le cadre de la stratégie seraient importantes pour défendre les échanges commerciaux à l’échelle mondiale mais ne devraient pas tenter d’intervenir dans des conflits interétatiques territoriaux spécifiques. Lisbonne encouragerait l’Union européenne à mobiliser des fonds sur la sécurité maritime et environnementale, ainsi que sur la gestion des crises et la médiation des conflits. Elle appuierait cette démarche en contribuant à la liberté de navigation, en renforçant l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe et en finançant les programmes de l’UE.
Compte tenu de sa position nationale sur la question, le Portugal accorde une grande importance à la sécurité maritime mais reconnaît que ses capacités nationales limitées se traduiraient par une contribution directe réduite dans ce domaine dans la région de l’Indopacifique. Même si le Portugal est engagé sur cette question de la gestion durable des zones de pêche, son manque de flottes de pêche importantes dotées d’une capacité industrielle, réduirait l’impact qu’il pourrait avoir.
Développement économique
La question de la connectivité – même si elle est encore loin d’être entrée dans le débat public – gagne du terrain dans le débat public et les média portugais. Ce débat porte principalement sur la dimension de la connectivité des ports avec l’Atlantique, à savoir le port portugais de Sines qui ces dernières années a suscité la désapprobation car la Chine en contrôle un terminal et s’intéresse à un second terminal. Il n’y a pas encore de débat autour de la mise en place de normes multilatérales mais le Portugal soutient les Principes du G20 sur les Investissements dans des infrastructures de qualité. Sa position vis-à-vis de la connectivité consiste principalement à la considérer comme un instrument de lutte contre les menaces qui pèsent sur les intérêts de l’UE, une clé d’accès aux marchés et un instrument d’influence et de coercition. Enfin, le Portugal aimerait s’assurer que les principes d’une connectivité durable, globale et respectant les règles internationales décrite dans le « Plan de connectivité Europe-Asie » sont suivis, en particulier dans un cadre garantissant la réciprocité et l’égalité des chances. Lisbonne n’a pas encore eu de discussion sur les outils d’assistance et de financement à employer, même si le gouvernement aimerait favoriser des outils multilatéraux. Le financement des projets de connectivité dans la région de l’Indopacifique devrait être flexible, ouvert à différentes parties prenantes mondiales et régionales et destiné à promouvoir un multilatéralisme efficace appliquant les règles. Il ne devrait pas dépendre uniquement d’un financement bilatéral, en particulier dans des situations où les capacités financières des parties concernées sont clairement asymétriques. Les critères pour prioriser les infrastructures de connectivité seraient les intérêts économiques, comme tremplin pour la promotion de la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et le droit international.
Une nouvelle discussion sur la démondialisation a lieu et a gagné du terrain depuis le déclenchement de la Covid-19. En général, le débat tourne autour de la nécessité de repenser les chaînes de valeur et d’approvisionnement mondiales et de trouver des fournisseurs plus proches et de réduire les risques de l’interdépendance mondiale. Il y a également quelques discussions sur la nécessité pour l’Europe (et le Portugal) de se réindustrialiser et de passer à une économie plus numérique. De même, le Portugal a connu une nouvelle vague de débats sur la diversification et la relocalisation, motivés par l’argument selon lequel le pays pourrait bénéficier d’une réorganisation des chaînes de valeur mondiales. Le Portugal a toujours été favorable au multilatéralisme et serait un fervent défenseur des accords de libre-échange qui impliqueraient de nombreux pays de l’Indopacifique. Cependant, compte tenu de l’immense taille et de la complexité de la région, il donnerait sa préférence à des accords bilatéraux ciblés.
République tchèque
Vision de l’Indopacifique
En République tchèque, la discussion sur l’Indopacifique est menée par le ministère des Affaires étrangères qui considère l’approche de l’UE envers cette région comme fondamentale pour sa politique étrangère et ses objectifs de défense. Pour Prague, la délimitation géographique de l’Indopacifique va de la côte orientale de l’Afrique à la côte occidentale des Amériques tandis que la stratégie elle-même devrait être concrétisée par un ensemble global de mesures. Les critères de décision pour mettre en œuvre ces mesures devraient tenir compte des intérêts économiques de l’UE et des menaces régionale sur les intérêts stratégiques de l’UE, de la coercition économique de la part des rivaux systémiques, du changement climatique et des considérations environnementales, mais également du développement durable, des droits de l’homme, de la sécurité « douce » (menaces non-militaires contre la sécurité) et de la connectivité.
Indopacifique : stratégie de l’UE
Prague comprend que l’Indopacifique est à la fois une aubaine pour l’Europe et un instrument pour négocier avec la Chine. Ainsi, la stratégie Indopacifique de l’UE représenterait une affirmation de l’autonomie stratégique. Les partenaires clé de la région seraient les suivants (dans l’ordre d’importance) : l’Inde, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon. L’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN), le Canada et la Nouvelle-Zélande sont d’autres acteurs qui pourraient être des partenaires clé de la région. La Chine, en revanche, n’est pas considérée comme un partenaire attaché aux mêmes valeurs mais plutôt comme un acteur qui – dans certains domaines – devrait être davantage surveillé.
Sécurité européenne
Prague apprécierait qu’un volet sécurité soit adopté dans le cadre de la stratégie et considérerait cela comme complémentaire à des priorités européennes plus traditionnelles telles que le commerce et le développement durable. Mis à part la sécurité maritime, la lutte contre le terrorisme, la gestion de crises et la médiation des conflits, la République tchèque serait favorable aux investissements dans la cyber sécurité et dans la sécurité des réseaux 5G tout en s’attaquant aux menaces hybrides telles que la désinformation, en travaillant en coopération avec des organisations attachées aux mêmes valeurs comme l’Otan. En ce qui concerne le pilier de la sécurité maritime de la stratégie, Prague serait prêt à apporter son soutien par le biais d’un réaménagement des exportations d’armes, d’un renforcement de l’aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe. Dans le domaine maritime, la République tchèque privilégierait les activités axées sur le développement durable maritime, en particulier dans le cadre du respect du droit international, la garantie de la sécurité des routes commerciales comprenant la suppression de la piraterie et la surveillance des activités de la Chine. À cet égard, la gestion des zones de pêches ne jouerait pas un rôle central dans les priorités de Prague pour cette région.
Développement économique
Il n’y a guère de discussion au sujet des infrastructures de connectivité pour le moment, même si le ministère des Affaires étrangères envisage d’entamer cette discussion dans l’année. Jusqu’à présent, la connectivité n’a été abordée que dans des consultations ad-hoc avec les ministères du Commerce et des Transports, dans le cadre de partenariats de connectivité avec le Japon et l’Inde. Par conséquent, il n’y a pas eu de véritable discussion au sujet de la mise en place de normes multilatérales pour des investissements dans des infrastructures de qualité, mais il est probable que Prague suivrait les Principes du G20 sur les Investissements dans des infrastructures de qualité. La connectivité est considérée principalement par Prague non pas tant comme un outil de coercition mais plutôt comme un instrument d’influence. D’autres aspects de la connectivité, selon l’ordre de préférence, font que la connectivité fait partie de la politique de développement et est indispensable à l’accès des marchés. D’autres domaines potentiels de coopération liés au cadre de la connectivité porteraient sur des aspects tels que l’énergie, les transports, le numérique et la recherche et le développement ; en outre, Prague rechercherait également la coopération dans des activités liées à l’espace, ce qui est particulièrement approprié étant donné que l’Agence pour le programme spatial de l’UE est installé à Prague. Quant aux moyens de se procurer des capitaux pour financer une partie des activités stratégiques, Prague pense que la meilleure option serait de mobiliser une combinaison de sources de capitaux, notamment le recours à des fonds privés. Tout bien considéré, l’objectif final des projets de connectivité devrait être motivé par l’intérêt économique. Prague est favorable à une approche libérale de la politique commerciale qui englobe les efforts accrus visant une plus grande diversification des flux commerciaux, que le gouvernement considère comme un outil précieux pour garantir des opportunités pour les entreprises, les emplois et la croissance économique tchèques. Le gouvernement a des sentiments mitigés en ce qui concerne la relocalisation des chaînes d’approvisionnement : d’autre part, il craint que cela déplace la production à faible valeur ajoutée vers des pays moins chers ; en revanche, à la lumière de la crise de la Covid-19, il est conscient de l’importance des chaînes d’approvisionnement.
Prague serait d’accord pour négocier des accords de libre-échange bilatéraux (ALE) dans la région plutôt d’un seul accord global qu’il serait difficile de conclure. Vis-à-vis de la Chine, le gouvernement aimerait tout d’abord voir la mise en place de l’Accord global sur les investissements, qui comporte un volet sur la protection des investissements. Les partenaires viables en matière d’ALE pourraient être la Corée du Sud et le Vietnam, alors qu’en général les partenaires clé seraient le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
Dans la sphère technologique, la République tchèque accorderait la priorité à la cyber sécurité, à la gouvernance des données et aux partenariats 5G. Par ailleurs, elle aimerait bien voir l’application des droits de l’homme incluse dans le contexte de la technologie (comme par exemple la protection des données personnelles), dans les flux de données transfrontaliers et dans le commerce ouvert.
Roumanie
Vision de l’Indopacifique
La politique de la Roumanie dans la région de l’Indopacifique est dirigée par le ministère des Affaires étrangères qui accorde une haute priorité à la formation d’une stratégie européenne. Sa définition géographique préférée de l’Indopacifique serait qu’elle s’étendrait de la côte orientale de l’Afrique à la côte occidentale des Amériques. Les critères mis en avant pour la définition opérationnelle de la stratégie seraient : la promotion des intérêts économiques de l’UE, éviter les menaces régionales qui pèsent sur les intérêts stratégiques de l’UE et la défense contre la coercition économique par des rivaux systémiques.
Indopacifique : stratégie de l’UE
Le ministère des Affaires étrangères maintient que le concept de l’Indopacifique est à la fois une aubaine pour l’Europe et un outil stratégique clé de lutte contre la Chine. Pour la Roumanie, adopter une stratégie Indopacifique formerait partie de la gestion de l’alliance transatlantique. En ce qui concerne l’établissement de partenariats, la Roumanie estime que l’Europe ne devrait pas seulement s’associer à des pays présentant un solide caractère démocratique, même si elle accorde effectivement une certaine importance à cet aspect. Pour la Roumanie, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Chine sont les partenariats potentiels les plus importants à nouer dans la région, ainsi que les pays membres de l’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN), en particulier ceux qui sont « attachés aux mêmes valeurs » à un niveau multilatéral, comme Singapour.
Sécurité européenne
Le ministère roumain des Affaires étrangères déclare que les activités sécuritaires seraient une composante importante de la stratégie UE-Indopacifique. Et ce parce qu’il souhaite rester aligné avec les partenaires transatlantiques, où l’appartenance à l’OTAN est largement à l’ordre du jour malgré le fait que la sécurité de la Roumanie soit davantage menacée à proximité, à savoir par l’agression russe dans la région de la mer Noire. Selon la Roumanie, les domaines les plus importants en termes de sécurité dans lesquels l’Union européenne doit investir sont la cyber sécurité, la gestion de crises et la médiation des conflits. Pour assurer la sécurité maritime dans l’Indopacifique, la Roumanie serait prête à contribuer à la liberté de navigation, à rééquilibrer les exportations d’armes, à renforcer l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe et à participer au financement des programmes de l’UE.
Pour la Roumanie, la durabilité des ressources marines n’est pas la plus haute priorité mais reste toutefois importante. Son importance pour la Roumanie est liée à la mise en place d’une navigation maritime durable car le pays bénéficie de la logistique de ses propres ports et de leur exploitation. Ceci n’est cependant pas une question centrale. De même, la gestion durable des zones de pêche est seulement moyennement importante, compte tenu de la petite taille de son marché de produits de la mer. Toutefois, pour s’aligner avec la politique de l’UE elle apporterait son soutien.
Développement économique
Les discussions sur les infrastructures de connectivité en Roumanie se répartissent en deux thèmes principaux : celui de la connectivité interne et nationale et celui de la connectivité externe. Les discussions sur la connectivité interne ont porté sur le retard de la Roumanie par rapport aux autres États membres de l’UE. Le gouvernement a lancé un Plan national de relance et de résilience pour examiner les questions concernant le raccordement des foyers au gaz et aux réseaux électriques. Les discussions sur la connectivité externe portent sur la connectivité énergétique et sur les projets énergétiques de la région. La clé en est le gazoduc BRUA ainsi que l’espoir de Bucarest que la Roumanie parviendra à jouer un rôle clé dans la gestion du Couloir maritime de transport mer Noire-mer Caspienne. En matière de connectivité interne, la Roumanie n’aurait guère l’intention de soutenir la mise en place de normes multilatérales pour des investissements dans des infrastructures de qualités, car il est peu probable qu’elle puisse appliquer ces normes elle-même ou les imposer à d’autres. La connectivité en Roumanie est principalement vue comme faisant partie de la politique de développement ainsi qu’une clé d’accès aux marchés. De manière générale, elle est moins considérée comme menaçant les intérêts européens ou comme un instrument d’influence. Quant à l’Indopacifique, la Roumanie n’a aucune approche claire des projets de connectivité. Toutefois, on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que la Roumanie adhère à l’approche de Bruxelles de rester alignée avec les autres États membres de l’UE. Les discussions sur les méthodes de mobilisation pour les projets de connectivité dans l’Indopacifique n’ont pas beaucoup avancé en Roumanie. Le pays estime que les priorités de l’UE concernant les stratégies de connectivité dans l’Indopacifique devraient porter davantage sur les infrastructures numériques et de transport.
Il n’est pas beaucoup question de la démondialisation dans le débat public en Roumanie, étant donné que le pays a largement bénéficié de la mondialisation ces derniers temps. Lorsque ces discussions ont quand même lieu, elles sont menées par des groupes politiques marginaux eux-mêmes souvent influencés par une propagande qui prétend que la mondialisation est un danger pour les « valeurs nationales orthodoxes ». Les discussions sur la diversification et la relocalisation de chaînes d’approvisionnement ont bien émergé en Roumanie à la suite des pénuries de matériel médical durant la Covid-19. Toutefois, une fois les approvisionnements rétablis, les discussions ont porté sur la façon dont l’UE devrait consolider le marché unique et sa résilience. Dans la mesure où la Roumanie est un marché relativement petit et dépendant de la puissance de négociation de l’UE, même avec des discussions sur la diversification et la relocalisation des chaînes d’approvisionnement, peu de suggestions pratiques ont été faites.
Sur le thème des accords de libre-échange bilatéraux (ALE), la Roumanie a été à la fois un soutien et un promoteur, y compris durant sa présidence du Conseil de l’UE. Cela inclut l’accord UE-Singapour qui a été ratifié peu de temps après avoir accédé à la présidence. Cependant, la position de la Roumanie n’est pas très claire sur les futurs accords ALE bilatéraux ou globaux ou s’ils devraient inclure la Chine. Les pays qu’elle considèrerait comme les plus essentiels pour soutenir l’initiative ALE sont l’Inde, le Japon et l’Indonésie, où la politique de la concurrence et les réglementations sur les subventions et les entreprises publiques sont les aspects les plus importants des futurs ALE. In termes de technologie, Bucarest aimerait se concentrer davantage sur l’innovation et la commercialisation, suivies par les partenariats 5G et la cyber sécurité.
Slovaquie
Vision de l’Indopacifique
Les discussions sur l’Indopacifique sont principalement menées par le ministère slovaque des Affaires étrangères. Cependant, il semble que les différents ministères ne sont pas tous d’accord entre eux. Pour Bratislava, une approche européenne de l’Indopacifique n’est que relativement importante et sa définition géographique de l’Indopacifique va du Pakistan aux Îles du Pacifique. En termes de définition opérationnelle, Bratislava utiliserait comme critères les intérêts économiques de l’UE, les menaces de la région sur les intérêts stratégiques de l’UE, la coercition économique par des rivaux systémiques, le climat, les considérations environnementales et la connectivité.
Indopacifique : stratégie de l’UE
Le ministère de la Défense et le ministère des Finances considèrent tout deux l’Indopacifique comme une aubaine pour l’Europe et comme un outil stratégique de lutte contre la Chine. Toutefois, le ministère des Affaires étrangères a décrit la question comme « non reconnue ». D’autres désaccords sont dus aux différentes interprétations de la stratégie UE-Indopacifique, où le ministère des Affaires étrangères déclare que ce serait une affirmation de l’autonomie stratégique européenne. Le ministère de la Défense, quant à lui, pense que c’est également une façon de gérer les alliances transatlantiques et le ministère des Finances un moyen de s’aligner avec les États-Unis. Ces désaccords se poursuivent dans les discussions pour savoir quels partenaires clé choisir dans l’Indopacifique, excepté le fait que tous les ministères ont choisi les Etats-Unis comme partenaire le plus important. Le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Finances ont également donné la priorité à l’Australie et à la Chine, tandis que le ministère de la Défense préfère le Royaume-Uni et l’Australie. Le ministère des Affaires étrangères pense que les pays membres de l’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN) sont des partenaires importants. Le caractère démocratique de ces pays pèsera aussi énormément au moment de choisir leur partenariat.
Sécurité européenne
Le ministère de la Défense accorde une grande place aux activités sécuritaires liées à la stratégie UE-Indopacifique, en les considérant comme très importantes en cette période où la région connaît de plus en plus de défis et de tensions. La priorité des investissements de l’UE en matière de sécurité devrait être la sécurité maritime et environnementale, la lutte contre le terrorisme, avec un effort particulier sur la cyber sécurité, la gestion de crises et la médiation des conflits. Pour soutenir la stratégie sécuritaire maritime, la Slovaquie serait d’accord pour renforcer l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe. Le ministère des Affaires étrangères a également déclaré que la Slovaquie apporterait son soutien politique. La durabilité des ressources marines ne serait pas la première des priorités pour Bratislava mais elle est quand même assez importante, étant donné que la reprise socioéconomique durable et verte est nécessaire suite à la pandémie de Covid-19. De même, la gestion durable des zones de pêche serait également assez importante pour la Slovaquie et le pays serait d’accord pour contribuer aux activités de contrôle des zones de pêche dans la région. Le ministère des Affaires étrangères suggère que la Corée du Sud soutienne la politique en matière de rivières et de lacs.
Développement économique
La Slovaquie a poursuivi la discussion sur les infrastructures de connectivité, notamment sur le lien avec la Chine. Le pays est devenu de plus en plus sceptique à l’égard des projets d’infrastructure financés par les Chinois et la Slovaquie a un historique de réseaux 4G fortement saturés mais elle a développé lentement la 5G et la fibre optique. Toutefois, il n’y a pas eu de débat significatif sur la mise en place de normes multilatérales pour les investissements dans des infrastructures de qualité. La définition slovaque de la connectivité varie selon les ministères car le ministère des Finances considère la connectivité comme une clé d’accès aux marchés et comme faisant partie de la politique de développement, tandis que le ministère des Affaires étrangères la voit plutôt comme une menace pour les intérêts européens. Les discussions portent peu sur les manières d’aider, de financer ou de garantir les projets de connectivité en dehors de la Slovaquie, car en raison de la pandémie de Covid-19 le ministère des Finances a déclaré qu’il se concentrait sur les projets intérieurs. Le ministère des Finances a également fait part de sa préférence pour que les futurs projets de connectivité dans l’Indopacifique mobilisent la Banque européenne d’investissement, en mettant l’accent sur les infrastructures numériques et de transport, et qu’ils soient motivés par des intérêts économiques.
Il n’y a pas eu de grandes discussions sur la démondialisation économique en Slovaquie – uniquement en ce qui concerne la protection des traditions culturelles. De même, pratiquement personne n’a parlé de la diversification et de la relocalisation des chaînes d’approvisionnement. En ce qui concerne les accords de libre-échange (ALE), la Slovaquie est très favorable à des ALE bilatéraux, afin de les rendre aussi globaux que possible, selon le ministère des Affaires étrangères. Dans le même temps, le ministère de la Défense accorde davantage d’importance aux ALE bilatéraux avec des partenaires stratégiques attachés aux mêmes valeurs. Ces partenaires clé incluraient l’Australie, le Japon, les membres de l’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN), la Corée du Sud, Taiwan et les États-Unis. Pour la Slovaquie, les normes environnementales et sociales des partenaires des ALE ne sont que relativement importantes, tout comme la politique de la concurrence et la protection du climat et les droits de la propriété intellectuelle. La réglementation des subventions, cependant, serait très importante. La Slovaquie estime que la coopération en matière de recherche et développement, la gouvernance des données et les partenariats 5G seraient les aspects technologies les plus vitaux d’une stratégie Transpacifique.
Slovénie
Vision de l’Indopacifique
L’approche de la Slovénie à l’égard de l’Indopacifique est menée par le ministère des Affaires étrangères qui pense qu’une approche européenne de la région est très importante pour sa défense et sa politique étrangère. Il définit l’Indopacifique comme les pays qui bordent soit l’océan Indien, soit l’océan Pacifique. Selon Ljubljana, la future stratégie devrait porter sur les intérêts économiques de l’Union européenne, les menaces de la région qui pèsent sur les intérêts stratégiques et la coercition économique de la part des rivaux systémiques.
Indopacifique : stratégie de l’UE
La Slovénie voit dans l’Indopacifique une alternative économique à la Chine mais ne pense pas nécessairement qu’une stratégie sur la région devrait devenir un outil à utiliser contre la Chine. Elle considère que l’Union européenne est en mesure de jouer un rôle en équilibrant l’aptitude de la Chine à tirer profit de sa présence économique croissante pour constituer des blocs d’électeurs à l’Assemblée générale des Nations unies, ainsi qu’en diversifiant et équilibrant l’influence systémique sur les pays de l’Indopacifique. Pour autant, la Slovénie verrait l’adoption d’une stratégie Indopacifique comme un geste de l’UE pour s’aligner avec les États-Unis. Les partenaires clé dans l’Indopacifique devraient inclure le Royaume-Uni, suivi des Etats-Unis et de la Chine. Ljubljana considère aussi des pays plus petits ou de taille moyenne de l’Asie du Sud-Est comme des partenaires potentiels, comme la Malaisie qui est un pays nettement plus petit que la Chine mais qui a du potentiel économique. Au moment de décider quels pays seraient les meilleurs partenaires, la Slovénie considère que le caractère démocratique ou autre d’un pays est seulement assez important.
Sécurité européenne
Ljubljana considère les activités sécuritaires dans le cadre de la stratégie UE-Indopacifique comme assez importantes ; tout comme le gouvernement Trump, la Slovénie a co-signé une déclaration sur la sécurité de la 5G qui effectivement ciblait la Chine. De même, dans le programme pour la présidence slovène du Conseil, elle a inclus l’expression « souveraineté numérique » et la nécessité de travailler avec des partenaires démocrates dans l’Indopacifique. Les domaines sécuritaires à prioriser pour les fonds de l’UE sous la rubrique de la stratégie seraient la cyber sécurité, la gestion de crises et la médiation des conflits.
En termes de sécurité maritime, l’aide que la Slovénie offrirait porterait sur le renforcement de l’aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe, le financement des programmes de coopération bilatérale et un soutien politique sur des questions juridiques relatives à la mer de Chine méridionale, notamment sur des questions de droit international et de droit de la mer. Le développement durable maritime et des pêcheries n’occupent pas la même place pour la Slovénie que dans d’autres pays ; elle ne possède qu’une très petite flotte de pêche, un seul navire et un avenir incertain concernant ses droits économiques dans la mer Adriatique.
Développement économique
Les discussions sur les infrastructures de connectivité en Slovénie n’en sont qu’au début, centrées largement sur les pays voisins en vue de s’intégrer avec eux. En ce qui concerne l’Indopacifique, Ljubljana considère les infrastructures de transport comme un outil stratégique dans la région, surtout pour soutenir l’économie mondiale à l’avenir. Les discussions sur les infrastructures de 5G se sont accélérées en Slovénie, ce qui a nécessité la création d’un système de certification européen, et pour les fournisseurs d’équipement de réseaux de télécommunications centraux et périphériques de respecter les normes de sécurité conformément à la boîte à outil 5G de l’UE.
La Slovénie a également eu d’importantes discussions sur la mise en place de normes multilatérales pour les investissements dans des infrastructures de qualité dans le pays. La Slovénie interdit aux grosses entreprises de construction chinoises comme Ginex International de participer aux projets d’infrastructure majeurs slovènes, suite à l’échec de la signature de l’accord de l’OMC sur l’ouverture des marchés publics ou l’absence d’accord sur les marchés publics de l’UE ou avec la Slovénie. En Slovénie, on considère principalement la connectivité comme un instrument d’influence ou de coercition, ainsi qu’une clé d’accès aux marchés. Le pays n’a pas de position spécifique sur les outils de financement ou de garantie qu’il privilégierait pour soutenir les projets de connectivité dans l’Indopacifique, autrement, la préférence devrait être donnée aux instruments financiers de l’UE, notamment la Banque européenne d’investissement. En termes de stratégie, la Slovénie donnerait sa priorité aux infrastructures numériques, puis aux infrastructures de transport. Elle veut aussi voir une approche proactive contre toute menace sécuritaire éventuelle vitale, coercition systémique ou hégémonie régionale pendant que l’UE poursuit ses propres intérêts économiques dans les projets d’infrastructures de connectivité.
La Slovénie a très peu discuté de la démondialisation mais le scepticisme à l’égard de la mondialisation s’est accentué surtout depuis la « crise migratoire » en 2015 et a gagné du terrain pendant la pandémie de Covid-19. Le gouvernement de centre-droit du pays formule les intérêts nationaux slovènes en termes de souveraineté – en opposition à la migration, au multiculturalisme et à l’ingérence excessive des organisations internationales. Une partie du monde universitaire critique les modèles néolibéraux de la croissance internationale qui se traduit par un dumping environnemental et social. Il y a toutefois quelques discussions bien ciblées en Slovénie sur la diversification et la relocalisation des chaînes d’approvisionnement, notamment dans l’alimentation et l’agriculture, compte tenu du déficit commercial national du pays, sur la fluctuation des prix du marché et sur les pressions concurrentielles dans le secteur. Avec la pandémie de Covid-19, la Slovénie est favorable au renforcement de la résilience de chacun des secteurs aux crises qui entraînent des pénuries de marchandises ou des interruptions des exportations et du marché de la demande.
Ljubljana estime que les accords de libre-échange bilatéraux (ALE) devraient être prioritaires, ainsi que des ALE régionaux globaux ultérieurement. Cette stratégie est spécifiquement destinée à exclure la Chine. Dotée d’une économie petite et ouverte où le commerce représente plus de 100 % de son PIB, la Slovénie a traditionnellement soutenu les accords de commerce internationaux négociés par l’UE, et en particulier une politique commerciale fondée sur des règles contre le protectionnisme et favorable aux normes internationales et aux conditions de concurrence loyale. La Slovénie soutient en particulier la formation d’un accord de commerce global avec les partenaires transatlantiques, décrivant les Etats-Unis comme partenaire clé dans la formation de cet ALE, sans oublier l’Indonésie, l’Inde et l’Australie. Les normes sociales et environnementales des partenaires potentiels ne sont que moyennement importantes pour la Slovénie, et la protection du climat n’est pas importante. Les questions liées à la protection des droits de propriété intellectuelle et à la politique concurrentielle sont considérées comme beaucoup plus importantes. En ce qui concerne l’Indopacifique, la Slovénie prioriserait la cyber sécurité et les partenariats 5G dans la politique technologique.
Suède
Vision de l’Indopacifique
C’est le ministère des Affaires étrangères qui mène les débats sur l’Indopacifique en Suède. Sa position est qu’une approche européenne est seulement relativement importante dans ses priorités en matière de défense et de politique étrangère. La Suède définit l’Indopacifique comme la région s’étendant de la côte orientale de l’Afrique à la côte occidentale des Amériques. Dans la nouvelle stratégie Indopacifique de l’Union européenne, la Suède donnerait priorité aux intérêts économiques de l’UE, aux menaces de la région sur les intérêts stratégiques de l’UE, au changement climatique et aux considérations environnementales, ainsi qu’au développement international dans la région.
Indopacifique : stratégie de l’UE
En Suède, les décideurs politiques ont tendance à voir l’Indopacifique comme une opportunité pour l’Europe et considère l’adoption d’une stratégie européenne comme une affirmation de « l’Europe mondialisée », soulignant le rôle mondial de l’UE tel qu’il est fondé sur la coopération entre des partenaires aux valeurs et aux intérêts communs. La Suède estime que les partenaires clé de l’UE dans la région sont la Corée du Sud, les États-Unis et l’Australie, ainsi que Singapour. Stockholm apprécie également les partenariats avec l’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN), l’Association sud-asiatique pour la coopération régionale (ASACR) et l’Initiative du Golfe du Bengale pour une coopération technique et économique multisectorielle (BIMSTEC). Que ces partenaires soient démocratiques est important pour la Suède mais ce n’est pas un facteur primordial.
Sécurité européenne
La Suède considère que les activités sécuritaires sont seulement relativement importantes pour une future stratégie UE-Indopacifique, même si elle mettrait l’accent principalement sur la sécurité maritime, cyber et environnementale, ainsi que sur la lutte contre le terrorisme, la gestion de crises et la médiation des conflits. Pour soutenir les stratégies de sécurité maritime dans l’Indopacifique, la Suède serait prête à contribuer à la liberté de navigation, à renforcer l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe, et à financer à la fois les programmes de coopération bilatérale et les programmes de l’UE. Toutefois, la durabilité des ressources marines dans le cadre d’une stratégie Indopacifique arrive en haut des priorités pour la Suède, étant donné que la durabilité des ressources marines est déjà couverte par la Politique commune de la pêche. La gestion durable des zones de pêche n’arrive pas aussi haut que d’autres priorités pour la Suède.
Développement économique
Des discussions sont en cours en Suède sur les infrastructures de connectivité et le débat porte principalement sur le développement des infrastructures de transport nationales dans les pays partenaires, comme par exemple la modernisation des voies ferrées. Il existe également un vaste consensus sur l’urgence des investissements européens dans les infrastructures mondiales, pour faciliter le commerce et la mobilité. Il n’y a pas de discussion claire sur les normes multilatérales pour les investissements dans des infrastructures de qualité. La « connectivité » se réfère essentiellement à l’accès aux marchés et au fait de faire partie de la politique de développement. Les discussions sur la connectivité en Suède ne portent pas seulement sur les infrastructures mais également sur la connectivité numérique et humaine, ainsi que sur le développement durable, la croissance verte et la concurrence fondée sur des règles. Pour financer et faciliter les projets de connectivité dans l’Indopacifique, la Suède est favorable à un soutien financier à l’échelle européenne pour renforcer une approche de l’UE unifiée, en particulier par le biais de la Banque européenne d’investissement. Idéalement pour la Suède, ces projets donneraient la priorité aux infrastructures de transport et d’énergie et au changement climatique. La Suède mettrait principalement en avant les projets de connectivité favorables aux intérêts économiques européens.
La démondialisation est devenue un sujet de discussion en Suède, notamment dans le secteur privé qui craint que les tendances de la démondialisation ne nuisent aux bénéfices et n’augmentent les coûts. Suite à la pandémie de Covid-19, les discussions sur la démondialisation ne parlaient pas de ramener la production en Suède mais étaient plutôt centrées sur la gestion de crises et l’établissement de stocks d’équipement de crise. À partir de là, il y a eu d’importantes discussions sur la diversification et la relocalisation des chaînes d’approvisionnement en Suède, où la Confédération des entreprises suédoises a mis en garde ceux qui prônent cette tendance pour une plus grande autonomie stratégique car elle serait très onéreuse. Dans le même temps, certains acteurs recherchent des alternatives à la Chine mais voient peu d’options fiables, craignant la bureaucratie et le protectionnisme historique de l’Inde et d’autres économies qui n’ont pas la taille de la Chine.
La Suède estime que les accords de libre-échange bilatéraux (ALE) sont préférables à des accords ALE régionaux et globaux dans l’Indopacifique, ce qui évite d’interminables négociations nécessaires pour obtenir un résultat avec cette dernière. Stockholm pense qu’un ALE entre la Chine et l’UE est une priorité économique mais la vision générale de l’état des droits de l’homme en Chine rend les souhaits de la Suède peu clairs. La Suède considère que les membres de l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (TPP11), l’Inde et l’Indonésie sont les futurs partenaires ALE les plus importants. La Suède accorde une très haute importance aux normes environnementales et sociales chez un partenaire ALE, ainsi que les mesures visant à protéger le climat, les droits de la propriété intellectuelle et la politique concurrentielle. Les priorités technologiques pour la Suède dans une stratégie Indopacifique seraient d’inclure des partenariats 5G, des pratiques responsables en matière d’IA, l’électrification, la diminution des émissions de CO2 dans l’Indopacifique et la dimension juridique du cyber espace.
À propos des auteurs
Frédéric Grare est chercheur pour le programme Asie de l’ECFR.
Manisha Reuter et la coordinatrice du programme Asie de l’ECFR.
Remerciements
Les auteurs aimeraient remercier le ministère français des Affaires étrangères, le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale et la Fondation européenne pour le climat et leur soutien financier sans qui cette recherche n’aurait pas été possible. Ils souhaiteraient également exprimer leur reconnaissance à leurs collègues de l’ECFR actuels et anciens, en particulier Rafael Loss et Julia Pallanch, pour leur aide dans la gestion des données sur lesquelles se fonde l’analyse – ainsi qu’Adam Harrison, Chris Raggett et toute l’équipe de communications pour leur travail de rédaction et la production de graphiques. Que soit remerciée tout particulièrement Janka Oertel pour son aide formidable dans la mise en forme de l’article. Ce projet a dépendu plus que tout des 28 chercheurs de l’ECFR de toute l’Europe qui ont travaillé sans relâche, envers qui les auteurs sont profondément redevables.


L'ECFR ne prend pas de position collective. Les publications de l'ECFR ne représentent que les opinions de leurs auteurs.

